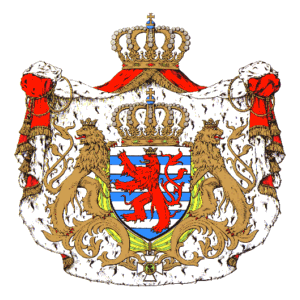
Histoire du Grand Duché du LUXEMBOURG
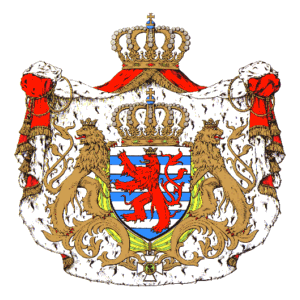
Si l’histoire connaît le Luxembourg, sous des formes diverses, depuis plus de mille ans, le grand-duché proprement dit est de création récente. Son titre remonte à 1815, le territoire actuel à 1839 ; l’avènement de la maison des Nassau-Weilburg date de 1890 ; le sentiment national s’est formé et constamment renforcé après 1867. Mieux que la géographie, l’histoire en explique-t-elle l’existence et la survie ?
Des origines au congrès de Vienne
Région habitée à l’aube des temps historiques par des Gaulois et des Germains, ensuite romanisée à partir de Trèves et de Metz, christianisée sous l’influence romaine et plus durablement par des moines anglo-saxons tel saint Willibrord au VIIe siècle, régie par les Francs mérovingiens et leurs successeurs carolingiens, entraînée dans les partages de la Lotharingie, elle a subi le destin de la Belgica Prima et de l’Austrasie, avant de devenir, au bénéfice de la famille d’Ardenne ou des Wigéric, un « territoire » médiéval.
Comté, puis duché (1354), le Luxembourg connut tour à tour, durant le Moyen Âge, de graves éclipses et de brillants apogées. Patiemment, Sigefroi, le constructeur du château fort de Luxembourg, et ses successeurs avaient grignoté les terres et les revenus des abbayes voisines, réuni de nombreux vassaux, obtenu de hautes fonctions dans l’Empire, telle la direction du duché de Bavière, quand Henri IV de Namur et de Luxembourg perdit le tout au profit du Hainaut (1194). Mais sa fille Ermesinde, par deux mariages et une sage gestion, récupéra Luxembourg, Durbuy, Laroche et y ajouta le marquisat d’Arlon. Le pays dorénavant, et jusqu’à la révolution belge de 1830, s’étendait de part et d’autre de la frontière linguistique romano-germanique et, partant, sur deux entités culturelles. Il est resté marqué à jamais par cette double appartenance. Cruellement défaite à Worringen (1288), la maison de Luxembourg accéda vingt ans après à la plus haute dignité politique de l’époque, celle de l’empire. Ses chefs, dont quatre furent empereurs (Henri VII mort en Italie en voulant y rétablir le pouvoir impérial ; Charles IV qui refit l’empire sur des bases allemandes et tchèques ; Wenceslas et Sigismond), participaient alors avec des fortunes diverses (Jean l’Aveugle succomba à Crécy en secourant le roi de France) au règlement de toutes les grandes questions européennes du bas Moyen Âge.
Négligé par ses princes occupés ailleurs, le pays fut conquis par Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1443), et passa avec l’héritage bourguignon aux Habsbourg d’Espagne. Il fut alors compris dans le cercle de Bourgogne établi par Charles Quint ; il dépendait toutefois plus de Bruxelles et de Madrid que de l’empire, tout en se trouvant séparé du reste des Pays-Bas espagnols par la barrière des Ardennes et du pays de Liège. Le duché de Luxembourg et comté de Chiny développait et gardait ainsi, sous des princes étrangers, ses traits particuliers. Disposant par son Conseil provincial d’une large autonomie administrative et judiciaire, resté uniformément catholique dans la tourmente de la Réforme grâce au gouverneur Pierre Ernest de Mansfeld et à la Compagnie de Jésus, le pays aurait pu connaître une existence paisible à l’abri des solides structures sociales de l’Ancien Régime. Il n’en fut rien : l’importance stratégique de la forteresse de Luxembourg l’entraîna dans les longues luttes des Bourbons et des Habsbourg, de la France révolutionnaire et du reste de l’Europe, puis dans celle de Napoléon III et de la Prusse bismarckienne. Au traité des Pyrénées (1659), le Luxembourg fut amputé des régions de Thionville, Montmédy, Marville, Carignan ; il tira quelque profit de 1684 (prise de Luxembourg par Vauban) à 1698 du régime centralisateur et réparateur du Roi-Soleil, de 1715 à 1795 des réformes d’abord lentes et paisibles, puis (sous Joseph II) plus brusques des Habsbourg éclairés d’Autriche. La conquête par les troupes du Directoire en fit pour vingt ans, et contre son gré, le département des Forêts.
Le grand-duché depuis 1815
Au cours du XIXe siècle, le Luxembourg connut des statuts complexes. Le congrès de Vienne, affaire des princes et non des peuples, accorda le grand-duché, diminué au profit de la Prusse de ses cantons de l’Eifel (Bitburg), à Guillaume Ier d’Orange-Nassau, roi des Pays-Bas, allié de la Grande-Bretagne et de la Prusse. En même temps, le pays devint, avec sa partie wallonne, l’un des trente-neuf États de la Confédération germanique, afin de compenser des pertes de territoires subies par les Nassau en Allemagne. Dans la capitale et forteresse, la garnison se composait de troupes prussiennes.
Lassée de l’absolutisme vexatoire de Guillaume Ier, la population, en général, ne s’opposa pas à l’emprise belge après 1830. Il en résulta une situation confuse jusqu’au traité de Londres de 1839, qui ratifia le troisième démembrement du pays, laissant cinq districts sur huit (le Luxembourg belge actuel) à la Belgique. À la suite de ces avatars, les Luxembourgeois prirent de plus en plus conscience de leur particularisme, soutenus après 1840 par la confiance de Guillaume II. Ayant heureusement échappé aux dangers divers de l’annexion en 1867 (affaire du Luxembourg, nouveau traité de Londres proclamant la neutralité désarmée du grand-duché) et en 1870-1871, dissociés des Orange-Nassau par l’application du pacte de famille nassovien en 1890, forts de leur expansion démographique et économique, ils réussirent à tenir tête, sous la grande-duchesse Marie-Adélaïde, à l’occupation allemande durant la Première Guerre mondiale, à certaines avances françaises et belges en 1919 et à la germanisation brutale par le régime hitlérien entre 1940 et 1944 ; la grande-duchesse Charlotte et le gouvernement Dupong-Bech avaient alors rallié la cause des Alliés en choisissant l’exil à Londres et Washington. De la sorte, le grand-duché fut à même, après la Seconde Guerre mondiale, de participer en tant qu’État souverain à la formation de l’Europe économique et politique.
Le régime politique interne est passé de l’absolutisme mitigé du prince à la monarchie constitutionnelle et parlementaire : constitution libérale en 1848, réaction autoritaire en 1856, libéralisme accentué depuis 1868, souveraineté de la nation et suffrage universel masculin et féminin en 1919. Les partis politiques actuels, excepté le Parti communiste, se sont formés peu après 1900 ; libéraux bourgeois, socialistes anticléricaux, chrétienssociaux, ils portent encore partiellement la marque des luttes idéologiques de cette époque. Les gouvernements sont de coalition. À l’exception des années 1974-1979 (gouvernement libéral-socialiste dirigé par Gaston Thorn) et d’une brève éclipse en 1925, les chrétiens-sociaux (Émile Reuter, Joseph Bech, Pierre Dupong, Pierre Werner, Jacques Santer) président depuis 1918 des gouvernements formés tour à tour avec les socialistes ou les libéraux. Un essai d’union nationale a tourné court dans l’après-guerre.