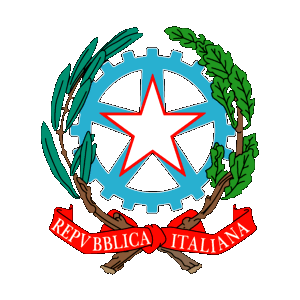
Histoire de la République Italienne
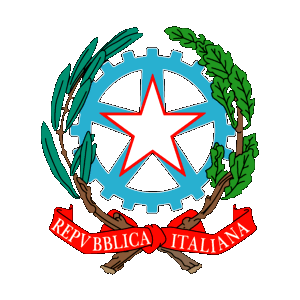
Péninsule méditerranéenne, fortement
ancrée au monde alpin, l’Italie est un pont naturel entre l’Orient et l’Occident,
et participe au destin de ces deux mondes. Seule région occidentale vraiment
marquée par les civilisations méditerranéennes antiques, elle a continué au haut
Moyen Âge à transmettre à ses voisins les impulsions venues d’Orient, avant de
conquérir à son avantage des postes avancés en Méditerranée orientale. Ce
courant ininterrompu qu’elle reçoit, puis suscite, la maintient longtemps dans
l’orbite des empires byzantin et musulman, dont la domination s’étend, plusieurs
siècles durant, sur certaines de ses régions; il la place au premier rang des
pays d’Occident, lors du renouveau économique des Xe et XIe siècles. Établissant
des comptoirs dans toute l’Europe et la Méditerranée, gagnant les extrémités du
monde connu, les Italiens, par leur richesse et leurs techniques avancées,
dominent l’économie du bas Moyen Âge.
Mais la multiplicité des grands centres urbains qui
deviennent des communes autonomes, embryons de futures principautés, les
souvenirs antiques imprégnant une idéologie impériale plusieurs fois rénovée, la
présence enfin du Saint-Siège, puissance spirituelle et temporelle à la fois,
empêchent l’Italie de rester politiquement unie. L’histoire de l’Italie revient,
en fait, à l’histoire, multiple, des Italiens. Seul le Sud, plus profondément
orientalisé, garde une cohésion politique, qui, à la fin du Moyen Âge, se
perpétue sous des dominations étrangères. Exploité par les Toscans et les
Vénitiens, il est ravalé au rang de pays colonial, et le restera longtemps.
Il faudra attendre 1870 pour que soit achevée la construction
de l’unité nationale. Du XVIe au XIXe siècle, la péninsule demeure à l’écart des
grands États européens. Son sol et son climat ne sont pas favorables aux
spéculations industrielles; la prépondérance atlantique la met en marge des
grands courants économiques; la précocité du phénomène urbain la prédispose au «
campanilisme » et à l’émiettement politique. Elle demeure adonnée à une
civilisation de qualité, et non de masse, et elle subit, par cycles successifs,
l’hégémonie des puissances qui imposent leur prépondérance à l’Europe: la France
des Valois, jusqu’au milieu du XVIe siècle, puis l’Espagne, jusqu’à l’aube du
XVIIIe siècle; l’Autriche enfin, jusqu’en 1796. L’ère des Lumières façonne des
élites qui adhèrent au despotisme éclairé, puis acceptent les innovations de la
« grande nation » française du Directoire et de l’Empire. L’insertion de
l’Italie dans le système napoléonien lui apporte les grandes acquisitions de la
Révolution de 1789 et, à travers une réorganisation territoriale dictée par
Paris, elle permet une première expérience de vie commune; elle enracine la
conscience, puis la revendication de la nationalité. La Restauration de 1815
ramène l’Ancien Régime, mais l’action de la génération du Risorgimento érode
lentement l’absolutisme. La politique romantique des complots et des
révolutions, de 1821 à 1848, l’idéalisme de Mazzini le cèdent au réalisme de la
bourgeoisie modérée, au juste milieu libéral, au dynamisme économique. Le
Piémont de Cavour incarne l’espérance des Italiens. Il trouve, contre
l’Autriche, pour « diplomatiser la Révolution », le concours militaire de
Napoléon III. Mais le chemin est malaisé, de la proclamation du royaume
d’Italie, en 1861, à la « Rome capitale », de 1870. Le premier demi-siècle de la
monarchie unitaire dissimule mal le retard des structures socio-économiques, la
pauvreté des masses, la coupure entre le Nord et le Midi. L’Italie connaît une
succession de crises aiguës et de vastes ambitions. Son désir d’être une grande
puissance n’est pas à la mesure de ses moyens. La faveur des foules va des
empiristes, héritiers de Cavour, comme Depretis ou Giolitti, aux condottieri
providentiels: Garibaldi, Crispi, Mussolini. Éveillé tardivement, après 1898, à
la révolution industrielle, le jeune royaume, au sortir de la « belle époque
giolittienne », est confronté à l’épreuve de la Grande Guerre, engagée contre le
vœu profond du pays. Les désillusions de la « victoire mutilée » font éclater
les déficiences de l’État libéral, puis entraînent son abdication devant la
dictature montante. Le ventennio fasciste (1925-1945) voit, après les succès de
Mussolini, jusqu’en 1936, la « germanisation » croissante du régime et sa
subordination à l’Allemagne de Hitler. Précipitée dans la Seconde Guerre
mondiale, l’Italie en sort vaincue, ruinée et reprend le chemin difficile d’un
nouveau Risorgimento.
1. L’Italie primitive
L’Italie antique est assez mal connue. La
grandeur de Rome a effacé son histoire, négligée par la plupart des historiens
anciens. Rome a pourtant fondé son empire sur la conquête préalable et
l’assimilation de la péninsule. Sa civilisation doit en outre beaucoup aux
habitants du Latium, aux Étrusques et aux villes grecques du Sud. À partir du
moment où s’achève la conquête, vers 270, une période nouvelle commence: les «
alliés » italiens de Rome, avant même leur complète intégration au temps de
César, partagent désormais la destinée de leur capitale.
Peuples et langues
Deux théories, longtemps intangibles, sont
aujourd’hui abandonnées: d’une part, la correspondance étroite entre peuple et
culture n’apparaît plus comme nécessaire; on rejette, d’autre part, les excès de
l’« invasionnisme », qui veut que l’Italie ait été peuplée et civilisée par des
vagues successives d’envahisseurs submergeant tour à tour de vastes territoires:
terramaricoles, Italiotes, Illyriens, Étrusques et Celtes. Les spécialistes (P.
De Francisci, M. Pallottino, J. Heurgon) préfèrent les solutions nuancées: dans
la plupart des cas, les diverses cultures ne résulteraient pas de la mise en
place brutale de groupes ethniques stables dès l’origine, mais se seraient peu à
peu élaborées durant des siècles d’obscure gestation et de contacts pacifiques.
Les peuples classiques de l’Italie sont les Latins de la
plaine de l’Italie centrale, entre le Tibre et les monts Albains; les Étrusques
entre le Tibre, l’Arno et la côte tyrrhénienne, qui occupèrent aussi la plaine
du Pô, peuplée de Celtes gaulois; les Ombriens de l’est du Tibre; dans
l’Apennin, les populations « sabelliennes » ou s’y rattachant, les Sabins, les
Samnites, les Marses, les Volsques, les Osques et, plus au sud, les Lucaniens et
les Bruttiens ; le long de la mer Adriatique, à l’extrême nord, les Vénètes,
puis les Picéniens, les Apuliens, les Iapyges et les Messapiens, proches de
certains peuples de l’Illyrie.
À quelques exceptions près (l’étrusque, notamment), les
langues de l’Italie sont indo-européennes, d’où le problème de l’origine de son
peuplement. La conception classique expliquait la parenté des langues italiques
par l’existence du fonds commun primitif indo-européen. Les travaux de G. Devoto
et de ses élèves insistent sur la différenciation progressive de deux groupes
linguistiques, le latino-falisque et l’oscoombrien, ce dernier plus proche du
grec et dont les « latinismes » proviendraient moins d’une parenté que d’un
voisinage prolongé.
Civilisations
Le matériel archéologique permet de
déceler plusieurs civilisations, sans que les peuples qui en sont porteurs
puissent être identifiés avec ceux dont la tradition historique nous a transmis
les noms. Au IIe millénaire, on distingue les palafittes incinérants de
Lombardie et Vénétie, les terramaricoles, dont on est amené à réduire le rôle,
une civilisation « apenninique » largement répandue dans les montagnes et les
régions voisines, et la civilisation des « champs d’urnes », attestée à travers
toute la péninsule, entre 1200 et 1000 avant J.-C. environ, parfois nettement
plus tard, car on ne saurait parler nulle part d’un développement strictement
linéaire.
Les Villanoviens (de Villanova, près de Bologne)
caractérisent le premier âge du fer, avec leurs tombes à incinération (urnes
biconiques) et leurs situles décorées de frises superposées. Leur expansion fut
considérable entre 950 et 500 environ. En Italie du Sud, leur civilisation se
mêle à la Fossakultur (inhumation dans des tombes à fosse), parfois très riche,
comme en Campanie. Dans la région intermédiaire (Campagne romaine, monts
Albains, Forum et Palatin de Rome même), on reconnaît une civilisation « latiale
» composite, dont les urnes-cabanes sont la marque distinctive.
2. L’Italie archaïque
À partir du VIIIe siècle, la péninsule, jusqu’alors assez isolée, s’ouvre à des influences nouvelles, venues de la mer et d’Orient. Auparavant, certes, les régions méridionales, mais plutôt la Sicile et les îles Éoliennes, avaient connu les Achéens de Pylos, tandis que les Phéniciens laissaient la trace de leur passage sur les côtes de l’Étrurie et du Latium, peut-être à Rome même (liens entre l’Hercule romain du Forum boarium et le Melqart tyrien?).
Les Étrusques
L’influence des Étrusques est autrement considérable, mais le problème de leurs origines reste discuté: aux solutions extrêmes, origine lydienne ou pélasgique de tout un peuple, ou à l’opposé autochtonisme absolu, on peut préférer des solutions moyennes, pouvant expliquer à la fois la présence évidente d’éléments orientaux dans cette civilisation, et la rapidité, presque la soudaineté, de son développement. Deux facteurs paraissent essentiels: l’arrivée par mer d’un contingent, certainement peu nombreux, d’Orientaux qui ont profondément modifié, en progressant vers l’intérieur, la civilisation villanovienne; la mise en exploitation des riches gisements de fer de l’île d’Elbe. Du Pô à la Campagnie et à Rome même, les Étrusques ont apporté la vie urbaine, l’architecture civile et religieuse, l’alphabet, la terre cuite architectonique, et ont largement diffusé l’hellénisme qui les avait conquis. Grâce aux entreprises des condottieri de Tarquinia, Vulci, Chiusi, à l’activité de leurs marins et de leurs métallurgistes, ils dominèrent économiquement et politiquement (au VIe s. av. J.-C. surtout) la majeure partie de l’Italie: Spina et Felsina (Bologne), Rome et Préneste, Capoue et Salerne furent, plus ou moins longtemps, des villes étrusques. Leur influence culturelle persista bien après la fin de leur grandeur politique, brisée par les défaites navales que leur infligèrent les Phocéens et les Syracusains (Alalia, vers 540 av. J.-C.; Cumes en 474 av. J.-C.).
Les Grecs en Italie du Sud
Les Eubéens de Chalcis et Érétrie, suivis de bien d’autres Hellènes, ont, à partir du milieu du VIIIe siècle avant J.-C. (la chronologie est toujours discutée), fondé de nombreuses colonies, de Rhegion à Cumes sur la côte tyrrhénienne, de Crotone à Tarente sur la côte méridionale. Cette installation ne se fit pas sans difficultés avec les indigènes de l’intérieur, notamment les Iapyges et les Lucaniens. Cependant, par le commerce et le prestige de sa culture, l’hellénisme occidental propagea en Italie, outre ses produits et ses techniques, ses grandes divinités (Déméter, Héra, Héraklès), l’orphisme et surtout le pythagorisme, et certains genres littéraires (comédie, poésie épique).
La Rome royale
Depuis le XVIIIe siècle, on épluche
l’histoire traditionnelle de la fondation de Rome et de ses rois. L’école «
hypercritique » (E. Pais) rejeta les données de l’annalistique. Mais
l’archéologie tend à réhabiliter certaines traditions sur l’ancienneté de la
ville, le rôle des « rois » étrusques, l’existence de sources authentiques très
anciennes (loi des XII Tables, fastes consulaires). Cependant, l’histoire «
événementielle » de Rome ne commence pas avant la fin du VIe siècle avant J.-C.
Les premiers établissements (fonds de cabanes, nécropoles de villages) remontent
bien au milieu du VIIIe siècle avant J.-C., au Forum boarium, sur le Palatin et
l’Esquilin. Plusieurs des villages situés sur les éminences (montes ) s’unirent
entre eux (Septimontium ), puis à ceux des collines (colles ) du Quirinal et du
Viminal, et, malgré l’absence de traces archéologiques, on admet une pénétration
sabine venue au contact des Latins. L’ère préurbaine prend fin avec l’œuvre des
rois étrusques, les Tarquins et Servius Tullius, qui firent de Rome une
véritable ville, entourée d’un rempart et d’une enceinte sacrée, munie d’un
égout drainant les marécages, et ornée de ses premiers monuments. Ces rois la
dotèrent aussi de ses premières institutions (magistrats, Sénat), de ses cadres
politiques (curies, tribus), et répartirent les citoyens en classes au sein
d’une phalange d’hoplites, la légion de six mille propriétaires aisés,
lourdement armés.
3. La conquête romaine
La République romaine
Divers points sont encore l’objet de discussions.
L’expulsion des Tarquins ne résulterait pas d’une révolution
intérieure, mais serait « un épisode du vaste conflit qui mettait aux prises
dans le Latium des coalitions militaires rivales » (J. Heurgon). C’est Porsenna,
roi tyran de Chiusi, qui aurait chassé Tarquin en prenant la ville (ce que la
tradition a pieusement dissimulé), qu’il entraîna dans sa première guerre avec
la Ligue latine, formée autour de Tusculum et d’Aricie.
La République serait née non pas exactement en 509 avant
J.-C., date probable de l’arrivée de Porsenna, mais un peu plus tard.
L’influence étrusque ne cessa nullement après l’expulsion des
rois: on connaît parmi les consuls des premières décennies des chefs de grandes
familles étrusques ayant partie liée avec l’aristocratie romaine. Cette
persistance de l’influence étrusque, attestée archéologiquement, a incité
certains savants à retarder jusque vers 475-470 avant J.-C. l’expulsion des
rois, ce qui semble excessif.
L’apparition des consuls, dont le nom même reste inexpliqué,
est obscure: après la chute des rois, on aurait créé deux praetores maiores au
lieu d’un praetor maximus , afin de satisfaire des tendances rivales, et ces
préteurs auraient reçu, dans la première partie du Ve siècle, le nom de consuls.
Enfin, l’origine du patriciat et de la plèbe n’est pas
claire: un antagonisme de classes a dû exister dès l’époque royale, et s’est
exacerbé plus tard, le patriciat étant en somme le résultat de la fermeture (la
« clôture », selon J. Heurgon) de l’ancienne aristocratie des gentes , désireuse
de se réserver les pouvoirs politiques (magistratures) et religieux
(sacerdoces).
De là vient la fameuse « lutte des deux ordres ». Favorisée
par les conditions économiques et militaires (organisation centuriate, tribus
territoriales, développement du commerce et de l’activité artisanale), la plèbe
usa de la force (sécessions) et des alliances politiques pour obtenir la
création des tribuns de la plèbe, la reconnaissance de ses assemblées (concilia
) et de leurs décisions (plebiscita ), la rédaction de lois écrites (loi des XII
Tables, œuvre des décemvirs au milieu du Ve s. av. J.-C.), et finalement
l’égalité complète dans une cité dont les institutions se précisèrent peu à peu
jusqu’à la fin du IVe siècle avant J.-C. Ce fut en réalité la victoire de la
noblesse patricio-plébéienne (nobilitas ), née des alliances matrimoniales et
des combinaisons de clientèles au sein de la classe riche. Mais, dans
l’intervalle, Rome avait conquis l’Italie.
Les étapes de la conquête
Dès le début, Rome dut se défendre contre
les coalitions et l’encerclement, et grandit peu à peu, malgré de nombreux
revers, grâce à la stabilité de ses institutions (rôle éminent du Sénat), à la
constance de ses citoyens, aidés de plus en plus par les contingents levés chez
les peuples déjà soumis, grâce aussi à une adroite politique de récompense des
fidélités. Elle se heurta successivement, et parfois simultanément, aux Latins,
aux Étrusques, aux Gaulois, aux Samnites et à certaines villes grecques de
l’Italie du Sud.
Les Latins formaient une fédération, le nomen latinum , avec
un conseil, un chef militaire fourni à tour de rôle par chaque peuple, et des
centres religieux. Rome en fit longtemps partie, et les conquêtes initiales
furent latines plutôt que romaines: les premières colonies, fondées aux limites
du Latium contre les Eques et les Volsques, sont latines, donc fédérales (Cora,
Norba, Satricum, Velitrae), la plus ancienne colonie proprement romaine étant
Ostie, en 335 avant J.-C. seulement. La Ligue latine fut affaiblie par les
conflits qui opposaient ses principales villes, Tibur, Préneste, Lavinium et
Rome elle-même, qui, plus forte, parvint à elle seule à s’opposer, puis à
s’imposer à l’ensemble de tous les autres peuples de la Ligue. En 338 avant
J.-C., elle fut dissoute, et le Latium unifié sous l’autorité romaine, les
villes diversement traitées perdirent d’importantes parties de leur territoire,
et leurs habitants, jouissant d’un droit inférieur (jus Latii ), vinrent doubler
les effectifs légionnaires. Bien avant cette date, Rome avait dû lutter contre
les Étrusques de Véies, contre les montagnards de l’intérieur, attirés par les
plaines côtières et la mer, se débarrasser des Gaulois qui l’occupèrent vers 390
un court moment, après le désastre de l’Allia, et furent longtemps menaçants.
Les Romains, peuple terrien, s’ouvrirent aux choses de la mer en s’alliant avec
la cité étrusque Caeré, en pénétrant en Campanie menacée par les Samnites, ce
qui mit Rome en rapport avec Capoue et Naples. Un traité fut peut-être conclu
avec Marseille vers 386, un autre, plus assuré, avec Carthage en 348.
La conquête entra dans sa phase décisive avec les guerres
samnites. Les Samnites de l’Apennin central et méridional étaient un ensemble de
tribus « sabelliennes », robustes et prolifiques, à l’étroit dans leurs
montagnes pauvres. Ils formaient une confédération solide, dont la cohésion
était cimentée par des rites sauvages, et la force militaire accrue par un bon
armement, que les Romains adoptèrent en partie (javelots, bouclier long). Pour
en venir à bout, ceux-ci nouèrent des alliances avec les peuples menacés,
contournèrent le Samnium en fondant des colonies en Apulie et sur l’Adriatique,
et tentèrent en vain de forcer leur route directement (défaite des fourches
Caudines, en 321). Leurs communications avec la Campanie furent plusieurs fois
menacées (voie Latine, future voie Appienne). À la fin de la seconde guerre
samnite, Rome entreprit la conquête des villes étrusques, vers Chiusi et Arezzo,
et de l’Ombrie. La troisième guerre (298-290) fut la plus dure, car autour des
Samnites se forma une coalition des peuples menacés par l’ambition romaine, des
Étrusques et des Gaulois du pays sénon (au nord de l’Ombrie). En 295, la
victoire difficile de Sentinum disloqua la coalition, sans terminer les
hostilités. Les années suivantes, l’Étrurie fut soumise, ainsi que les derniers
peuples encore en armes, Samnites, Apuliens et Lucaniens. Poussés par les
Campaniens, les Romains pénétrèrent dans le Sud et se heurtèrent à Tarente,
alors la plus puissante des villes grecques encore libres: la guerre contre
Pyrrhus, appelé par les Tarentins, dura de 280 à 272, et se termina par le
départ de Pyrrhus, battu à Bénévent en 275, et la chute de Tarente en 270. Rome,
maîtresse de l’Italie, était dès lors une puissance méditerranéenne: quatre ans
plus tard commençait la première guerre punique.
L’organisation de l’Italie au IIIe siècle
Le mérite de Rome fut de rassembler autour
d’elle les forces de l’Italie conquise: même au temps de la guerre d’Hannibal,
les défections furent rares. Un État romano-italique s’était formé, composé de
deux sortes de territoires: celui de Rome, ager romanus , dont les municipes
étaient autonomes et dont les habitants, rapidement romanisés, furent inscrits
dans les tribus « rustiques »; des colonies, romaines et latines, contrôlent ce
territoire d’environ trente mille kilomètres carrés; celui des cités et peuples
alliés, socii , dont le statut, plus ou moins avantageux, dépend d’un traité,
foedus , fixant leurs obligations fiscales (tribut) et militaires (contingents
auxiliaires). L’Italie devait ainsi se romaniser progressivement: introduction
de ses citoyens dans la communauté romaine (droit romain et droit latin), rôle
politique et social des grandes familles locales admises dans la nobilitas
(Étrusques, Sabins, Campaniens d’abord), diffusion du latin, élaboration d’une
civilisation romano-italique par emprunts réciproques dans le domaine de la
religion, des mœurs et des arts. La participation des alliés italiens aux
grandes conquêtes méditerranéennes et aux guerres puniques, les souffrances même
endurées en commun et les avantages acquis (butins, afflux d’esclaves,
enrichissement général de la péninsule) parachevèrent l’assimilation des esprits
et des mœurs, trop vite même pour l’égoïsme conservateur de certains éléments
sénatoriaux: de 90 à 88, de nombreux peuples alliés durent prendre les armes
pour arracher enfin la « naturalisation » complète de l’Italie. Mais dès la fin
de la seconde guerre punique, celle d’Hannibal, au début du IIe siècle, son
histoire se confond pratiquement avec celle de sa métropole incontestée.
Après l’absorption du dernier des royaumes hellénistiques,
Rome achève, au moment où va s’ouvrir l’ère chrétienne, l’unification de la
Méditerranée sous sa domination. Son histoire est désormais liée à celle d’un
vaste empire qui durera cinq siècles avant de s’effondrer sous les coups des
invasions barbares.
4. De l’Italie antique aux Lombards
La date de 476 (chute du dernier empereur romain d’Occident), limite théorique de l’Antiquité et du Moyen Âge, ne vaut que pour l’Italie, seule région où l’autorité impériale s’exerçât encore. Là même, la coexistence de l’empereur et du maître des milices (généralement barbare) et la supériorité de fait de celui-ci sont communes au Ve siècle. Aussi le skire Odoacre, maître des milices et chef d’armées barbares au service de l’Empire, installées selon le régime de l’hospitalitas (considérés comme « hôtes », les soldats jouissent du revenu du tiers des terres de certaines régions), a-t-il continué de gouverner l’Italie à la manière romaine; il s’appuie sur le sénat, après avoir détrôné l’empereur Romulus Augustule et envoyé à Constantinople les insignes impériaux; les armées barbares n’ont pas part au gouvernement.
Théodoric
Cette autonomie déplaît à l’empereur d’Orient, qui cherche de plus à éloigner les Ostrogoths, qui ravagent les Balkans. Ce peuple, de religion arienne, est dirigé par Théodoric, qui a passé sa jeunesse comme otage à Byzance, et connaît donc bien l’administration romaine, mais dont les ambitions dépassent celles d’un délégué de l’empereur. Il entre en Italie, envoyé par celui-ci, en 489, et supprime Odoacre en 493. Sa politique, bien connue grâce à Procope et Cassiodore, ne diffère guère de celle de son prédécesseur; les Goths, stationnés comme « hôtes » en Italie du Nord, sont relégués aux fonctions militaires, et gardent leur droit national. L’administration reste romaine: les cités conservent leurs curies, les provinces leurs gouverneurs, l’Italie son préfet du prétoire, qui aide le roi avec les anciens ministres du gouvernement impérial. L’administration tend seulement à se centraliser. Les deux populations sont rigoureusement séparées, le roi garantissant l’équilibre de cette construction originale, bien différente des monarchies vraiment barbares. À la fin du règne, cet équilibre se rompt: en 524, le sénateur philosophe Boèce est exécuté pour avoir souhaité une restauration impériale; en 526, le pape Jean Ier meurt en prison. Or, à la mort de Théodoric (526), les tendances trop romaines de sa fille Amalasonthe entraînent une réaction des nationalistes goths, qui la tuent en 535; Justinien, qui vient de conquérir l’Afrique vandale, envoie Bélisaire en Italie; la « guerre gothique » dure vingt ans, et laisse à Justinien, en 555, une Italie ravagée. Au cours de la guerre se révèlent les qualités stratégiques du roi goth Totila (541-552), qui recrute des troupes par la subversion sociale. C’est dans ce climat de violence que saint Benoît édicte sa règle monastique. La longue résistance du royaume goth prouve ses qualités. Le pays, bien gouverné, est prospère, grâce à l’habile politique fiscale des hauts fonctionnaires. Sa population, amoindrie, produit assez pour ses besoins. Le commerce, ralenti, est encore important. Seul le Sud est en décadence; mais guerres et épidémies du VIe siècle ont ruiné l’ordre social antique.
Justinien et la restauration byzantine
La restauration de l’Empire ébranle en effet cet ordre: aux ravages de la guerre succède la fiscalité très dure d’un empire qui n’a plus les moyens de sa politique; les compromissions religieuses avec les monophysites orientaux, un moment admises par Rome, créent en Italie du Nord un schisme qui durera un siècle et demi. Même les institutions traditionnelles sont mal respectées: Narsès est chargé d’un gouvernement militaire. On fortifie les frontières, face au monde barbare qu’ébranlent les Avars. L’éclat de l’art officiel ravennate ne doit pas masquer la situation réelle.
L’invasion lombarde
C’est en 568 que l’Italie est plongée dans l’univers barbare; partiellement du moins, car la division politique de la péninsule (qui durera jusqu’en 1860) en laisse des morceaux épars sous l’autorité de Byzance – principalement les futurs États pontificaux. Cette année-là, le peuple lombard, païen en grande partie, et qui ne connaît de Rome que ses institutions militaires, conquiert la plaine du Pô, puis l’Apennin jusqu’au Sud; le couloir byzantin entre Rome et Ravenne isole au VIIe siècle les duchés de Spolète et Bénévent, pratiquement indépendants du roi de Pavie. Les rudiments de l’organisation romaine permettent aux Lombards d’occuper le pays: les farae , groupes guerriers, sont amalgamées en exercitus dont chacun obéit à un duc, installé dans une cité ou un château. Quand le régime se stabilise (584), l’Empire réorganise les territoires qui lui restent sous l’autorité absolue de l’exarque de Ravenne, gouverneur général militaire.
L’exarchat de Ravenne
Sous l’autorité des militaires – exarque que son indépendance recommande de changer souvent, ducs de grandes unités territoriales (Vénétie, Pentapole adriatique, Rome, Naples), tribuns des villes –, l’administration civile s’étiole: les curies municipales disparaissent au VIIe siècle, le sénat n’apparaît plus dans les textes; à l’autonomie municipale est substituée la hiérarchie militaire; il en résulte une transformation sociale. Certes, la cité demeure essentielle; les artisans sont toujours groupés en collèges officiels; mais l’état de siège permanent implique l’enrôlement des citoyens en milices, qui sont à la base de la nouvelle organisation urbaine. De plus, arrivent en Italie de nombreux fonctionnaires et militaires bien payés en or; ils investissent leurs traitements en achetant aux petits paysans ruinés des terres que ceux-ci ne peuvent remettre en valeur, et se font concéder l’exploitation de biens d’Église; cette aristocratie de fonction, souvent militaire, devient terrienne, et tend à ressembler aux grands propriétaires occidentaux. Les querelles religieuses entre Rome et Byzance s’ajoutent au malaise social et aux exactions fiscales pour susciter de graves révoltes, surtout au VIIIe siècle. Le roi lombard Astolf prend sans peine Ravenne en 751, mettant fin à l’existence de l’exarchat. Seule la Calabre demeure encore grecque: Naples et la Vénétie sont de fait indépendantes; le pape s’emploie, avec l’aide des Francs, à mettre la main sur Rome et Ravenne. Le régime militaire a, du moins, fait pénétrer chez les Lombards quelques éléments de la civilisation orientale. Le clergé oriental, chassé par les hérésies impériales et l’invasion arabe, afflue à Rome, mettant à la disposition des papes de la fin du VIIe siècle des missionnaires qui peuvent reprendre l’œuvre d’évangélisation entreprise par Grégoire le Grand (590-604) auprès des Anglo-Saxons et des Lombards.
Le royaume lombard
En 584 monte sur le trône lombard Authari, marié à la Bavaroise Théodelinde, qui correspond avec Grégoire le Grand, et dont la famille, catholique, occupera le trône à la fin du VIIe siècle. Le roi remplace certains ducs trop indépendants par des gastalds recrutés parmi ses fidèles, et son gouvernement prend une allure romaine. Après les règnes expansionnistes et nationalistes du législateur Rothari (636-652) et de Grimoald (662-671), la dynastie bavaroise réussit avec les missionnaires orientaux à convertir les Lombards au catholicisme. La civilisation byzantine pénètre alors le royaume, traversé par de nouveaux courants commerciaux; ceux-ci mènent aux bouches du Pô les produits orientaux, que les marchands de Pavie redistribuent dans tout l’Occident depuis que la mer Tyrrhénienne est infestée par la piraterie arabe. Le royaume retrouve ainsi des formes de vie économique supérieure, et sa société se rapproche de celle de l’exarchat. Mais l’attitude agressive des rois du VIIIe siècle (Didier) envers Rome, à l’époque où le pape s’appuie sur la nouvelle puissance franque, amène le renversement de la monarchie nationale par Charlemagne en 774. Le royaume lombard (auquel est rattaché le duché de Spolète), tout en gardant sa personnalité et ses lois, dépend du roi des Francs auquel Bénévent, seul parmi les pays lombards, échappe.
5. L’Italie sous le régime franc
Les Carolingiens
En fait, des mouvements de révolte ainsi que l’idéal universaliste du roi l’amènent progressivement à introduire dans l’administration, puis dans les lois du royaume d’Italie (reconnu comme unité politique autonome dès 781) des éléments francs: les comtes austrasiens prennent la place des ducs lombards; les grands, Francs et Lombards, doivent entrer dans la vassalité royale, source, en Italie comme en Gaule, des institutions féodales; les Églises jouissent de l’immunité. Dès 751, le pape, qui appuie bientôt ses prétentions sur la fausse donation de Constantin, revendique les territoires de Rome et de Ravenne; le roi franc, avec le titre de patrice, devient le protecteur du nouvel État pontifical. C’est à ce titre que Charlemagne, appelé par Léon III en butte aux attaques de l’aristocratie romaine, va en 800 à Rome où le pape lui confère le titre impérial. Si Charles domine de fait le pontife, l’Église prend une place toujours plus importante dans les affaires de l’Empire sous ses faibles successeurs; Louis II (850-875), dont le titre impérial ne recouvre que la souveraineté de l’Italie, agit surtout comme agent du pape contre les Arabes, qui ont pillé Saint-Pierre de Rome en 846. Mais après le dernier empereur carolingien (888), la souveraineté du royaume d’Italie passe aux familles des grands marquis.
Venise
Seules en Italie du Nord, les îles vénètes restent toujours hors de l’emprise impériale. Indépendantes sous la souveraineté théorique de Byzance, elles voient leur population, puis leurs chefs (dont le doge ) se rassembler sur les îles du Rialto. Dès le IXe siècle, l’aristocratie des tribuns investit ses revenus, faute de mieux en ce pays d’eau et de sel, dans le commerce, important de Byzance les précieux produits orientaux que Pavie redistribue toujours à l’Occident.
Le royaume d’Italie
Cette période est, pour l’Italie, le premier âge féodal. La féodalité est née de la vassalité carolingienne; à ses vassaux, comtes et marquis, et autres grands, le roi a distribué, en rétribution de leurs fonctions et de leur fidélité, des domaines (bénéfices), à titre personnel. Mais dès le IXe siècle, les agents royaux se recrutent par hérédité; de même les autres vassaux; ainsi le bénéfice, devenu fief, tend à devenir patrimonial, et la fidélité due au roi, contractuelle, liée à la concession du fief. La féodalité italienne, semblable dans son principe à celle des pays francs, a cependant des caractères particuliers: les grandes circonscriptions féodales (marche, comté) gardent les contours des divisions territoriales lombardes, et sont centrées sur des cités; l’influence du droit romain rend plus apparent le caractère contractuel du lien féodal; le droit lombard interdit la succession par primogéniture, d’où les fiefs tenus par tous les descendants d’une famille; enfin, on distingue nettement les vassaux directs, et les vavasseurs, qui n’ont au Xe siècle que peu de droits, la décomposition du pouvoir royal profitant surtout aux marquis (Toscane, Frioul, Spolète, Ivrée). Bien que la distinction entre pouvoir public et possession de la terre soit plus nette qu’en pays franc, la féodalité s’appuie sur le grand domaine foncier, qu’ont dû développer les Carolingiens; mais il n’a pas le quasi-monopole économique et juridique, qui est le sien dans la Gaule du Nord: des artisans urbains, de libres possesseurs ruraux échappent à son emprise. Et le grand domaine ne répond pas au modèle classique de l’Ile-de-France: le lien y est faible entre réserve et tenures; celles-ci sont confiées, parfois par contrat, à des paysans aux statuts juridiques extrêmement variés. Pendant que les familles marquisales s’arrachent la couronne de fer, à Rome l’aristocratie locale et spolétine (les Théophylacte, Albéric) fait les papes au mieux de ses intérêts, mais souvent au détriment de l’Église.
6. Papes et empereurs
La restauration impériale
Les querelles dynastiques attirent en Italie le seul souverain puissant de l’Occident, Otton Ier, roi de Germanie, qui épouse Adelaïde, veuve du roi Lothaire. Couronné roi à Pavie en 951, Otton doit intervenir dans les États pontificaux; en 962, il est couronné empereur à Rome; le nouvel Empire réunit donc les couronnes de Germanie et d’Italie. Otton distribue les grands commandements à ses fidèles; de plus, se méfiant de l’hérédité, il confie des pouvoirs comtaux à des évêques, les plaçant dans la vassalité royale; d’où, au XIe siècle, la querelle des Investitures. À Rome, qu’il gouverne directement, il dépose le pape Jean XII; jusqu’au milieu du XIe siècle, la nomination du pape par l’empereur et la collaboration des deux pouvoirs assurent la dignité des successeurs de saint Pierre. Enfin, il inaugure les vaines descentes des empereurs dans le Midi. Son petit-fils Otton III (983-1002) porte à son apogée l’idée impériale; fils de la Byzantine Théophano, influencé par la nouvelle spiritualité monastique et érémitique, et par le droit romain, il veut faire régner la paix dans un empire vraiment romain, protège l’Église contre la petite féodalité, collabore avec le savant pape Silvestre II (Gerbert). Mais à sa mort, les vassaux de l’Église se rallient au marquis d’Ivrée, que l’empereur Henri II vainc difficilement. Et Conrad II (1024-1039), en reconnaissant l’hérédité de tous les fiefs, se concilie l’aristocratie au détriment de l’Église: à Milan, la lutte de ces deux forces préfigure les mouvements communaux. Mais cette fermentation de la société urbaine est alimentée par les idées de réforme de l’Église, préparées par les mouvements monastiques et introduites par les papes impériaux; à Milan, la Pataria , mouvement populaire rigoriste, exige un clergé débarrassé de la simonie et du nicolaïsme.
La réforme grégorienne et la première lutte du pape et de l’empereur
À Rome, à la faveur de la minorité de
Henri IV, le pape, à partir de 1059, revendique son autonomie pour purifier l’Église.
Grégoire VII (1073-1085) en vient à s’élever contre toute puissance laïque
pesant sur l’Église; d’où son idéal théocratique, et sa longue lutte contre
Henri IV qui, humilié à Canossa (1077), exile le pape, mais meurt excommunié;
car la réforme grégorienne menace l’autorité impériale sur les évêques, ses plus
fermes agents au XIe siècle. La lutte se termine par le concordat de Worms
(1122), qui précise les droits de l’Église et de l’empereur sur l’évêque et ses
biens. L’effacement de l’empereur au début du XIIe siècle laisse le pape en
butte à l’aristocratie romaine.
Politiquement troublés, les Xe et XIe siècles voient le grand
essor économique de l’Italie du Nord. Les centres de peuplement rural se
multiplient, souvent fortifiés, et permettent d’importants défrichements,
encouragés par des contrats favorables aux tenanciers. Et les villes, toujours
existantes, où vit la majeure partie de l’aristocratie féodale, attirent des
paysans.
7. Le Midi, carrefour des civilisations
À la fin du VIIIe siècle, Byzance ne garde en Italie que la Calabre et la Sicile; la côte napolitaine, byzantine en droit, est en fait indépendante; le reste du Midi obéit au prince lombard de Bénévent ; au vrai, à part la Sicile orientale hellénisée, la côte apulienne et Naples, le pays est peu peuplé, sans cités, sans hiérarchie religieuse. En 827, l’émir de Kairouan entreprend la conquête de la Sicile, où Byzance ne garde jusqu’en 902 que Taormine.
Les pays lombards
Le prince de Bénévent, un moment vassal de
Charlemagne, joue de la proximité de l’autre empire pour se rendre indépendant.
Entouré de dignitaires aux titres lombards ou byzantins, il fait difficilement
respecter son autorité dans ce pays quasi vide, où ses agents prennent de
l’indépendance.
Salerne en 849, Capoue un siècle plus tard deviennent les
centres de principautés concurrentes. À mesure qu’ils créent de nouveaux bourgs
fortifiés, les gastalds se rendent plus indépendants; de même les grands
monastères, tel le Mont-Cassin. Les structures politiques archaïques ne
résistent pas aux progrès économiques, surtout quand, au IXe siècle, les Arabes
puis les Grecs se sont emparés de la Pouille.
La côte napolitaine
La cité de Naples, terrienne malgré sa
situation, est confrontée à de semblables problèmes: le duc, indigène dès le
VIIIe siècle, se heurte au XIe siècle à l’aristocratie foncière et aux Lombards
cherchant un débouché maritime; il doit en 1030 installer à Aversa les Normands
de Rainulf et, un siècle plus tard, partager le pouvoir avec un début
d’organisation municipale.
En 839, Amalfi s’est détachée de Naples. Coincée sur une
plage minuscule, elle est, du IXe au XIIe siècle, avec Venise, le principal port
d’Occident; ses marins fréquentent l’Afrique du Nord au IXe siècle, Byzance et
l’Égypte au Xe; au XIe, Pantaleone fonde l’hôpital Saint-Jean de Jérusalem. En
supprimant son indépendance en 1076, les Normands ruinent son commerce.
La Sicile musulmane
En 831, les Arabes installent à Palerme une colonie permanente qui conquiert l’ouest puis le sud-est de l’île; les chrétiens du nord-est, soumis au Xe siècle, favoriseront la conquête normande. Après une période de troubles entre musulmans et chrétiens, et entre Arabes de Palerme et Berbères de Girgenti, le calife fatimide d’Afrique installe en Sicile en 948 un émirat héréditaire, qui voit l’apogée de la civilisation siculo-arabe dans la brillante cour de Palerme, une des grandes villes de l’Islam. Mais les troubles internes, aggravés par ceux de l’Afrique, divisent l’île entre émirs rivaux, dont certains appellent les Grecs, puis les Normands, qui héritent, en s’emparant de Palerme en 1072, d’une administration remarquable.
Les territoires grecs
Malgré les efforts de Louis II, c’est Byzance qui réussit à éliminer les bases arabes du continent (Bari, bouche du Garigliano). Autour de Bari, prise en 871, la domination grecque s’étend sur la Pouille et la Lucanie; on organise les trois thèmes (régions militaires) de Langobardie (Pouille), Calabre, puis Lucanie, regroupés vers 975 sous l’autorité du catépan de Bari. Au Xe siècle, Byzance doit repousser les Slaves, les Hongrois, les Arabes, les empereurs germaniques. Elle tente d’helléniser le sud de la région, en particulier grâce aux moines grecs fuyant la Sicile (saint Nil), et d’y implanter une hiérarchie ecclésiastique orientale, qui lutte en Pouille contre les évêques latins au moment du schisme de 1054. Au nord de la Pouille, la région frontière de Capitanate est garnie de forteresses. Mais la fréquence des révoltes des villes apuliennes montre la vanité des efforts d’intégration. La révolte de Melo (1009) introduit en 1016 en Italie du Sud les premières bandes d’aventuriers normands qui, installés à Melfi, ruinent la domination byzantine en s’emparant de Bari en 1071.
Le royaume normand
Les pèlerins normands recrutés par Melo
attirent des compatriotes avides de butin, et profitent des divisions politiques
pour établir leurs bandes à Aversa puis à Melfi, et ravager la Pouille et la
Calabre, où Robert Guiscard arrive vers 1046, puis servent à la papauté d’appui
contre les empereurs. Ils dominent l’ensemble du Sud après la prise de Bari;
Roger Ier, frère de Robert, arrache la Sicile aux musulmans. Son fils Roger II
groupe sous son autorité Midi et Sicile, et se fait couronner roi à Palerme en
1130.
Les Normands apportent avec eux un régime féodal fermement
tenu en main par le roi, qui codifie et contrôle, grâce au « divan des barons »,
des services militaires et financiers précis. Mais le réseau des fiefs, loin de
couvrir tout le pays, laisse de nombreuses terres en pleine propriété. Aussi
Roger II (1130-1154) et Guillaume Ier (1154-1166) organisent, s’inspirant des
traditions byzantine et arabe, une administration perfectionnée qui permet au
roi d’exercer directement sa souveraineté. Le roi, qui édicte des lois
(assises), est entouré de ministres – le Grand Émir des émirs en est le
principal – et assisté de bureaux, comme les divans financiers. Des officiers
(émirs, stratèges, gatalds, bailes) le représentent dans les villes, les
justiciers et chambriers dans les provinces, les maîtres justiciers et maîtres
chambriers dans les grandes unités territoriales. Une chancellerie trilingue
(arabe, grecque et latine) expédie les ordres du roi, que célèbrent les poètes
arabes et les clercs grecs. Cette centralisation suscite des révoltes des barons
et des villes apuliennes. Après le règne du faible Guillaume II, un hasard
dynastique livre en 1194 le royaume à l’empereur Henri VI.
Frédéric II
Son fils Frédéric II, ajoutant à son titre
impérial la souveraineté absolue du royaume, où il passe presque toute sa vie,
croit restaurer la puissance des Augustes. Ce personnage, l’un des plus
puissants du XIIIe siècle, attiré par l’Islam et sceptique, a longtemps attendu
en Sicile, pupille d’Innocent III, que les luttes européennes lui donnent
l’empire, et c’est dans le royaume que, grâce à l’administration normande, son
génie a pu s’exercer: en 1221, il révise tous les titres de possession; en 1224,
il fonde l’université de Naples pour former les agents royaux; sa pensée
souveraine s’incarne en 1231 dans le Liber Augustalis qui reprend toute la
législation sicilienne, comme dans les châteaux pleins de souvenirs antiques
qu’il bâtit en Pouille (Castel del Monte). Ses fils Conrad IV et Manfred (attiré
par l’Orient), son petit-fils Conradin poursuivent sa politique. Mais le parti
pontifical (guelfe), l’or florentin et les troupes franco-provençales de Charles
d’Anjou, frère de Saint Louis, écrasent les Hohenstaufen à Bénévent (1266) et à
Tagliacozzo (1268).
La brillante construction des Normands et des Souabes, si
elle a unifié le Midi, y a étouffé toute initiative autre que celle du roi. Le
pays semble suivre, dès le XIIIe siècle, la courbe descendante des empires
orientaux, au moment où l’Italie du Nord devient le plus puissant foyer
économique de l’Occident. Le royaume angevin sera un pays colonial ouvert à
l’exploitation des Vénitiens et des Florentins; la décadence du Sud recommence.
8. L’âge des communes
Les origines des communes
Aux XIe et XIIe siècles, le mouvement
communal transforme la carte politique de l’Italie en faisant des villes des
organismes politiques autonomes. Il est lié à un phénomène économique et à
l’évolution du monde féodal. D’une part, le renouveau du grand commerce qui met
l’Italie dès avant l’an mille en relation avec les mondes musulman et byzantin
favorise la croissance rapide des villes, suscite l’esprit d’initiative, le
désir d’autonomie des populations urbaines voulant allier richesse et
participation au pouvoir. D’autre part, l’évêque qui, grâce à des immunités ou à
des droits comtaux, est à la tête de chaque cité, voit se dresser contre lui les
propriétaires fonciers, devenus ses vassaux, et les officiers qu’il a nommés
pour exercer en son nom ses prérogatives. Ces notables prennent prétexte de la
réforme grégorienne pour refuser l’obéissance à l’évêque, qui est davantage un
agent, parfois simoniaque, des souverains germaniques qu’un pasteur soucieux du
bien de son troupeau. Ainsi la renaissance économique du XIe siècle et
l’évolution de la société ecclésiastique dans le monde féodal sont à l’origine
de la commune, association jurée de citoyens unis pour défendre les libertés de
leur ville. La création d’un corps permanent – les consuls –, chargé du pouvoir
exécutif, est le signe de la naissance d’une commune.
L’évolution ne fut pas uniforme dans toute la péninsule. Dans
le Sud, l’implantation de la monarchie normande mit fin aux velléités
d’indépendance des villes; celles-ci ne purent se donner des chefs, et furent
administrées par des bailes ou gastalds nommés par le roi. Au contraire, dans le
Nord, où Venise a acquis dès le IXe siècle une autonomie de fait, l’absence
prolongée des souverains germaniques favorisa le mouvement communal. Dès 1085 –
c’est le premier exemple connu –, Pise a ses propres consuls et, dans les années
suivantes, les autres villes importantes du royaume d’Italie l’imitent. Vers
1150, le consulat est la forme normale de gouvernement des villes dans l’Italie
du Nord et du Centre.
Communes, empereurs et Église
L’essor des communes inquiète rapidement
les empereurs, provoque des difficultés avec l’Église, des conflits entre villes
voisines. Désireux d’abaisser la puissance de la grande féodalité, les
souverains germaniques accordent des privilèges aux notables de quelques
communautés urbaines dès le début du XIe siècle. Henri V élargit les concessions
de ses prédécesseurs en reconnaissant l’existence de magistratures citadines. Au
contraire, avec le règne de Frédéric Ier (1152-1190), les rapports entre
l’empereur et les communes se tendent. Pour obtenir des rentrées fiscales et
faire respecter par les villes ses droits régaliens, le souverain réunit une
diète à Roncaglia (1158), et y expose son programme. Peu de villes prennent son
parti. Les autres se révoltent et s’unissent en une Ligue lombarde (1167)
soutenue par le pape Alexandre III, alors que Frédéric Ier favorise un antipape.
Battu à Legnano par les troupes communales (1176), l’empereur doit, au traité de
Constance (1183), reconnaître l’autonomie des villes, tout en gardant sur elles
une souveraineté théorique. Mais, à partir de 1220, Frédéric II prétend
restaurer l’autorité impériale au détriment des communes qui, menacées, trouvent
l’appui de la papauté.
Les relations des communes avec les clercs sont parfois
difficiles. En effet, des mouvements populaires hostiles à l’Église établie, et
renforcés par la prédication de mystiques et d’hérétiques, ajoutent leurs effets
au mouvement communal. C’est le cas à Rome où Arnaud de Brescia soulève le
peuple contre le pape et la noblesse et veut faire de la ville « la source de la
liberté et la maîtresse du monde ». En outre, des querelles de juridiction et
des différends fiscaux opposent des communes à leurs propres autorités
ecclésiastiques. Mais, lorsque Frédéric Ier menace les droits du pape en Italie
centrale, Alexandre III prend la tête de l’opposition à l’Empire; son attitude
contribue au succès des communes lombardes.
Alliées contre l’ennemi commun, les cités se divisent sitôt
la paix revenue. De graves conflits d’ordre stratégique et économique les
opposent entre elles. En effet, la commune ne peut se désintéresser de la proche
campagne. Elle y trouve des vivres, des troupes, de la main-d’œuvre pour ses
industries; elle peut y lever des impôts et contrôler les grandes routes
commerciales. Aussi s’efforce-t-elle très vite d’étendre son autorité à son
contado , en soumettant les féodaux ou en concluant des accords amiables avec
les communautés rurales. Cette extension provoque des conflits entre communes
limitrophes: Gênes et Lucques s’opposent à Pise, Bologne à Modène, Milan à
Pavie, Florence à Sienne et à Pistoia. Certains antagonistes trouvent plus
avantageux de rechercher l’alliance de l’empereur que de favoriser une commune
rivale en s’opposant à celui-ci. Dans ces luttes se développent l’esprit civique
et le patriotisme communal; Dante, tout exilé qu’il ait été, en est pour
Florence le chantre.
L’administration des communes
La participation active des citoyens au
gouvernement de leur cité caractérise le mouvement communal. Est citoyen
quiconque prend part aux charges de la ville et y réside depuis quelques années.
L’assemblée populaire, ou arengo , détient le pouvoir de décision aux premiers
temps de la commune. Puis des conseils la remplacent; ils aident dans leur
gestion les consuls, élus en nombre variable pour un temps très limité. Les
citoyens élaborent des statuts réglementant la vie publique et privée. Ils
contrôlent les finances, rendent la justice, conduisent des ambassades, mènent
les guerres. Ils s’occupent de travaux d’urbanisme, d’autant plus importants que
le palais communal, la grand-place et la cathédrale sont le symbole d’une
puissance citadine que célèbrent des historiographes officiels dans leurs
annales et leurs chroniques.
Des conflits d’origine sociale rythment l’histoire des
communes. Ils opposent les nobles au popolo , fraction évoluée du peuple.
Propriétaires terriens, chevaliers, s’adonnant parfois au commerce, les nobles
se groupent selon leurs liens de parenté en consorzerie qui se disputent les
charges consulaires. Le peuple s’organise en societas populi pour contrebalancer
le pouvoir des puissants. Au sein du popolo, les membres des corporations jouent
un rôle dynamique: au XIIIe siècle, ayant à leur tête un « capitaine du peuple »
et des « anciens », ils cherchent à obtenir la direction de la commune.
Ces luttes imposent la recherche d’un compromis. Pour exercer
le pouvoir à la place des consuls représentant les intérêts divergents de
groupes hostiles, on fait appel à un noble venu d’une autre ville, capable de se
tenir au-dessus des factions. Le podestat – tel est son nom – dirige la commune
pendant six mois ou un an, puis va exercer ailleurs ses talents. Parme, Padoue,
Bergame connaissent cette institution avant 1175; dès le début du XIIIe siècle,
le podestat s’est substitué aux consuls dans la plupart des communes. Il
s’efface à la fin du XIIIe siècle, quand le popolo, dominé par les marchands,
accapare les fonctions publiques. Les succès du « peuple » sont ceux d’une
bourgeoisie dont la croissance et la prospérité viennent de l’extraordinaire
essor économique que connaît l’Italie depuis le XIe siècle.
9. L’Italie, pôle de développement de l’économie occidentale
Les origines de l’essor économique
Le déclin de la vie d’échanges, sensible
dans tout l’Occident jusqu’au Xe siècle, a épargné les régions italiennes qui,
longtemps byzantines, ont maintenu des relations avec Constantinople et le monde
musulman. Amalfitains et Vénitiens portent en Orient des bois et des esclaves;
ils y achètent soieries, épices et drogues qui sont acheminées vers Pavie et
parviennent en Flandre dès la seconde moitié du XIe siècle. En 1082, Venise,
supplantant Amalfi, obtient l’usage presque exclusif du marché
constantinopolitain. Au même moment, Gênes et Pise arment des flottes pour
répondre aux pirateries des Sarrasins. Les croisades ne font qu’accroître une
vie de relations économiques déjà active en Italie au XIe siècle.
Les flottes italiennes transportent, protègent, ravitaillent
les croisés. En échange de leur aide, Génois, Vénitiens, Pisans obtiennent dans
les villes de Syrie franque des privilèges fiscaux et la concession d’un
quartier, embryon d’une colonie permanente. Les marchands italiens fréquentent
aussi les ports de Berbérie, Alexandrie, accroissent leur influence à
Constantinople où Pisans et Génois sont à leur tour admis. Malgré d’inévitables
rivalités entre les cités maritimes, des colonies italiennes se créent sur tout
le pourtour du bassin méditerranéen; en raison de leur avance technique, du rôle
qu’ils ont joué dans les croisades, les marchands italiens s’assurent le
monopole du commerce en Méditerranée.
Les formes de l’activité économique
L’Italie, pauvre en plaines, a une
vocation agricole médiocre. L’accroissement de la population, à partir du XIe
siècle, impose l’amélioration des anciens terroirs et la mise en valeur de
terres nouvelles. Les défrichements font reculer les espaces boisés; de nouveaux
villages se créent; de grands travaux de drainage sont entrepris dans la plaine
du Pô; vignes et olivettes prospèrent sur des terrasses aménagées. Des capitaux
urbains s’intéressent à l’aménagement de domaines ruraux, que stimule la
généralisation du métayage dans l’Italie des communes au profit des serfs
affranchis. Malgré ces progrès, la terre ne suffit pas à nourrir une population
en constant accroissement; pour les Italiens le commerce est une « frontière ».
Dans le renouveau des XIe et XIIe siècles, la vie d’échanges
occupe la première place. À l’organiser, les Italiens font preuve d’initiatives
originales, fondées sur les principes de l’association commerciale et de la
division des risques. Les contrats de commenda , de societas maris et de
colleganza permettent de réunir les capitaux et d’intéresser aux bénéfices du
commerce grands et petits investisseurs. Pour limiter les risques de mer, la
propriété et la cargaison des bateaux sont divisées en parts aisément
négociables. À Sienne et à Florence se créent des sociétés stables ou compagnies
qui groupent de nombreux participants. Ceux-ci mettent en commun leurs capitaux
et s’adonnent au grand commerce, mais aussi à la banque et à l’industrie. Sous
des formes diverses, les villes italiennes, surtout celles du Nord et du Centre,
s’enrichissent par une intense vie d’échanges.
Dans les ports barbaresques, les Italiens apportent les
produits d’Italie et d’Orient, et acquièrent l’or africain qui leur permet,
croit-on, d’équilibrer leur balance commerciale avec l’Orient; là même, ils
vendent des esclaves, des armes, des draps pour acheter des tissus précieux et
des épices. L’appât du gain pousse les marchands à se procurer directement les
produits orientaux. Ayant échoué contre l’Égypte, les Italiens créent autour de
Constantinople un empire latin dominé par Venise (1204), puis, après la
restauration byzantine de 1261, ils fondent des comptoirs en mer Noire où
aboutissent les routes de la soie et des épices. À la suite des missionnaires,
des marchands, tel Marco Polo, s’y hasardent et, profitant de la paix mongole,
gagnent l’Asie centrale, les Indes, la Chine même.
En Occident, la pénétration des hommes d’affaires italiens
est tout aussi intense. Dès la fin du XIe siècle, ils répandent outre-monts les
produits d’Orient, et y acquièrent les draps et la laine de Flandre et
d’Angleterre. Aucune denrée négociable n’échappe à leur activité: produits
alimentaires, matières premières pour l’industrie textile, armes et métaux, les
Italiens font commerce de tout. Ils animent les foires de Champagne puis, à la
fin du XIIIe siècle, s’installent dans les ports flamands et anglais, reliés à
l’Italie par des lignes maritimes régulières. La péninsule est ainsi au cœur du
grand commerce international. Elle en tire les plus importants profits. La
première en Occident, elle frappe à nouveau des monnaies d’or: génois, florin et
ducat sont le symbole d’une prospérité inégalée.
Les activités financières et industrielles découlent de
l’essor des échanges. En commerçant sur des marchés lointains, les marchands
italiens font progresser les techniques du change: change manuel puis, grâce aux
correspondants des compagnies établis dans les principales places de commerce,
contrats de change, enfin lettres de change (1291). Malgré l’interdiction
canonique du prêt à intérêt, aisément tournée, les pratiques du crédit se
développent. Les Lombards – gens de Plaisance et d’Asti – sont au XIIIe siècle
les intermédiaires financiers entre l’Italie et les foires de Champagne, puis se
consacrent au prêt sur gages en France et en Angleterre. Ils s’effacent ensuite
devant les compagnies siennoises et florentines qui deviennent à la fin du XIIIe
siècle de véritables institutions bancaires, recevant des dépôts, consentant des
prêts, assurant les transferts de fonds de leurs clients. Le Saint-Siège demande
aux Siennois de transférer à Rome le produit des décimes; après la faillite des
Buonsignori de Sienne, les compagnies florentines se disputent la clientèle de
la Chambre apostolique. L’habileté financière des Italiens est telle qu’ils
deviennent les conseillers des rois, les Frescobaldi auprès d’Edouard Ier
d’Angleterre, les Franzesi auprès de Philippe IV le Bel. Les Italiens sont les
inventeurs de la banque moderne.
Ils font aussi merveille dans les activités industrielles.
Une corporation florentine, l’Arte di Calimala , affine les draps
franco-flamands. Disposant des matières premières nécessaires, laines
d’Angleterre, d’Espagne et de Berbérie, coton, alun, produits tinctoriaux, les
Italiens créent une industrie lainière à Florence, à Milan où se développe aussi
la fabrication des futaines de coton, alors que Lucques commence à travailler la
soie importée d’Orient. Dans les villes maritimes, les industries textiles sont
une activité secondaire, car les constructions navales et la navigation
absorbent la main-d’œuvre disponible; l’arsenal de Venise, contrôlé par l’État,
est la plus puissante entreprise industrielle de l’Occident.
Cet essor économique stimule villes et campagnes. Les
premières s’étendent, construisent de nouvelles enceintes, s’enrichissent; les
secondes doivent produire plus de denrées alimentaires et fournir des hommes aux
industries urbaines. De profondes mutations sociales s’ensuivent: déclin des
féodaux du contado, croissance numérique d’un prolétariat urbain, essor de la
bourgeoisie qui répand une nouvelle culture fondée sur l’étude du droit, le
dédain de la théologie, le goût des œuvres en langue vulgaire qui permet à Dante
(1265-1321) d’imposer à toute l’Italie le dialecte toscan. Ces mutations
ébranlent les institutions communales; les convoitises étrangères et l’échec des
efforts de regroupement mènent au XIIIe siècle à des formes politiques
nouvelles.
10. Tentatives d’unification et divisions
Frédéric II: la lutte du Sacerdoce et de l’Empire
Petit-fils de Frédéric Ier Barberousse et
héritier par sa mère du royaume de Sicile, Frédéric II réussit à se faire
couronner empereur en 1220 et à réunir sous son autorité l’Empire et l’Italie du
Sud. Grâce à des vicaires impériaux, il veut étendre son hégémonie à l’Italie du
Nord et du Centre. Sa politique autoritaire suscite l’hostilité du pape et
l’inquiétude des communes. Grégoire IX excommunie l’empereur qui tardait à
accomplir son vœu de croisade; l’on voit ainsi un prince excommunié partir pour
les Lieux saints, négocier avec les Sarrasins et se faire couronner roi de
Jérusalem (1229). Dans l’Italie du Nord, les communes, partagées entre les
intérêts divergents de la bourgeoisie et des nobles, hésitent sur l’attitude à
prendre face à l’empereur; beaucoup penchent pour la résistance et reforment la
Ligue lombarde (1226). Les troupes communales sont écrasées par Frédéric II à
Cortenuova (1237). Ce triomphe trop éclatant suscite une réaction
anti-impériale; pour la seconde fois, l’empereur est excommunié. La lutte du
Sacerdoce et de l’Empire concerne désormais toute l’Italie.
Elle provoque une violente polémique. Des encycliques
pontificales formulent la doctrine théocratique, considérant le domaine temporel
comme une annexe du pouvoir spirituel. Libelles et manifestes impériaux
affirment le pouvoir absolu de Frédéric II qui, reprenant à son compte, dans un
but politique, les idées émises par l’humble prédication de saint François d’Assise
(1182-1226) et de ses disciples, se pose en réformateur de l’Église. Dans cette
lutte sans merci, l’empereur entend utiliser les ressources du royaume de Sicile
et les troupes venues d’Allemagne, pour soumettre l’Italie. Il paraît y réussir
jusqu’en 1243, lorsque le nouveau pape Innocent IV s’enfuit à Lyon, y convoque
un concile qui dépose Frédéric II (1245). Évincé de Parme, trahi par ses
vicaires impériaux, l’empereur perd l’Italie centrale, durement conquise, et
meurt vaincu en 1250.
Guelfes et gibelins
Ce long conflit a exacerbé les divisions
des villes et facilité le déclin des institutions communales. Pour des questions
de politique étrangère, mais aussi à la suite de rivalités de familles, deux
factions s’opposent dans chaque cité: l’une, favorable à l’empereur, forme le
parti gibelin; l’autre, hostile à l’hégémonie impériale et docile aux impulsions
pontificales, constitue le parti guelfe. Si certaines villes comme Pise sont
gibelines et d’autres comme Florence plutôt guelfes, la plupart des cités
connaissent des dominations successives des deux factions. Dans ces luttes, les
vaincus perdent leurs biens, leurs droits politiques, sont bannis et vont
reformer, près d’une cité amie, une commune en exil organisant la revanche; les
renversements politiques sont fréquents.
La mort de Frédéric II porte un coup sévère au gibelinisme en
Italie du Nord; mais en 1258, Manfred, bâtard de l’empereur, usurpe le trône de
Sicile et reprend la politique de son père. La curie romaine, pour éviter que
l’Italie tout entière ne retombe sous la coupe des Hohenstaufen, inféode le
royaume de Sicile à Charles d’Anjou, déjà maître de la Provence. Ayant conclu un
traité avec le pape, réuni une armée, obtenu le concours des compagnies
financières florentines, l’Angevin envahit l’Italie du Sud, se débarrasse de
Manfred puis du dernier Hohenstaufen, Conradin. Il étend son influence sur la
Lombardie, la Toscane, Rome même, grâce à un long interrègne pontifical, et
semble devoir unifier l’Italie autour de sa personne. Il noue des alliances
matrimoniales avec le roi de Hongrie, le prince d’Achaïe, et entend avec l’aide
vénitienne reconstituer l’Empire latin d’Orient, disparu en 1261. Ses succès ne
durent pas. Grégoire X, désireux de mettre fin au schisme oriental (concile de
Lyon de 1274), cesse de soutenir l’Angevin; le parti guelfe victorieux se
désagrège; les exigences fiscales du roi mécontentent les populations
méridionales livrées à l’exploitation des Toscans. Contre l’impérialisme de
Charles d’Anjou, le basileus , avec l’aide de Gênes, se rapproche du gendre de
Manfred, Pierre d’Aragon. Ce dernier s’empresse de saisir l’occasion que lui
offre la révolte des Vêpres siciliennes (1282), qui expulse les Français de
toute la Sicile. Les Angevins, malgré de longues guerres, ne peuvent reprendre
l’île, dont ils reconnaissent la possession au roi d’Aragon (1302), auquel
Boniface VIII a inféodé la Sardaigne.
Les premières seigneuries
Au cours du XIIIe siècle, les communes
perdent leur unité, mais aussi leur équilibre institutionnel. L’évolution n’est
pas partout semblable. Dans les villes où par le commerce et les activités
industrielles s’est formée une bourgeoisie puissante et riche, celle-ci
s’identifie à la commune et se l’approprie. Le popolo vainqueur juxtapose ses
propres représentants – « capitaine du peuple », anciens ou prieurs – au
podestat et aux conseils de la commune qui s’effacent. À Florence, les
ordonnances de justice de 1293 écartent les nobles des fonctions publiques; à
Venise, la « fermeture du Grand Conseil » éloigne de la vie politique active la
majeure partie des citoyens. Ici et là, une oligarchie accapare le pouvoir.
Ailleurs, le peuple las des luttes civiles et des guerres confie le sort de la
cité à un homme fort, et accepte de perdre la liberté pour gagner la paix. Plus
souvent encore, la commune est l’enjeu de conflits entre grandes familles
féodales; l’une d’elles l’emporte et, sous le couvert d’institutions restées
républicaines, affirme sa puissance: c’est le cas à Milan avec les Visconti.
À la commune se substitue ainsi la seigneurie, caractérisée
par la concentration du pouvoir dans les mains d’une seule personne et par
l’élargissement de la sphère d’action d’une ville à toute une région. Les
premières seigneuries apparaissent vers 1250; elles sont, à la fin du siècle, un
fait général en Lombardie et en Vénétie. Leur succès accentue la fragmentation
politique de l’Italie.
11. L’âge des condottieri et des princes
Faillite de l’Empire et de la papauté
Après la disparition des Hohenstaufen, l’empereur germanique se désintéresse de l’Italie, et le gibelinisme décline. Il ne reprend vie que lors des rares campagnes impériales en Italie: Henri VII, en qui Dante voyait l’instrument de la paix et de la justice, échoue, et meurt en Toscane en 1313; Louis de Bavière et Jean de Bohême ne sont pas plus heureux. Après 1350, l’Empire n’est plus qu’une royauté allemande. La papauté ne profite guère de cet effacement. La curie est déchirée par les dissensions entre cardinaux français et italiens. Boniface VIII, tout en poussant à l’extrême la doctrine théocratique, ne parvient pas à se faire obéir à Rome, et est humilié par les envoyés de Philippe le Bel à Anagni (1303). Clément V, pape français, transfère à Avignon le siège de la papauté, et l’Italie est désormais « un navire sans nocher » (Dante).
Royaumes, républiques et seigneuries
Restent face à face des royaumes en
déclin, des seigneuries triomphantes et quelques communes essayant de préserver
leur liberté. Robert d’Anjou, roi de Naples, ne peut reconquérir la Sicile;
nommé par le pape Jean XXII vicaire impérial en Italie, il est le chef des
guelfes, protecteur de Florence, mais se heurte à une coalition des seigneurs de
Lombardie. Dans son propre royaume, son autorité s’affaiblit devant
l’indépendance des barons et les appétits des commerçants florentins et
vénitiens. Après la mort de Robert (1343), les égarements de la reine Jeanne Ire
et les conflits entre branches angevines rivales provoquent une grave crise
sociale et politique. En Sicile, malgré la valeur de quelques princes aragonais,
le processus de désintégration féodale l’emporte sur les efforts de restauration
de l’autorité monarchique.
Dans l’Italie du Nord et du Centre se développent des
seigneuries puissantes qui cherchent à s’étendre grâce à l’action de bandes de
mercenaires, menées par des condottieri. Les Visconti de Milan conquièrent la
Lombardie puis, au temps de Jean Galeas, allié au roi de France, occupent
Vérone, Padoue, Pise, Sienne, Bologne, menacent Florence et transforment leur
principauté en duché. La mort subite de Jean Galeas en 1402 arrête
provisoirement cette expansion. La Savoie accroît ses possessions piémontaises,
et devient elle aussi un duché sous le règne d’Amédée VIII (1391-1431). La
concession d’un titre impérial fait de la seigneurie, devenue héréditaire, un
principat dont le chef, sans aucun lien avec son peuple, exerce une dictature
que tempèrent coups d’État et assassinats. Les nouveaux États territoriaux
absorbent peu à peu les petites seigneuries des Marches et de Romagne, et
menacent dans leur existence les dernières grandes communes.
Gênes connaît au XIVe siècle une instabilité chronique qui la
conduit à s’offrir à Robert d’Anjou, à se donner à partir de 1339 des doges
perpétuels, mais trop vite renouvelés, puis, par crainte des Visconti, à
accepter comme maître le roi de France Charles VI. Son impérialisme maritime se
heurte en Orient aux intérêts vénitiens; trois longues guerres opposent les deux
rivales, sans vrai résultat. À Venise, le régime aristocratique se consolide,
malgré les conspirations de Bajamonte Tiepolo et du doge Marino Falier. La
République se fait conquérante pour assurer sa sécurité; elle se constitue un
État de Terre-Ferme comprenant Padoue, Vicence, Trévise, occupe l’Istrie puis le
Frioul et une partie de la Dalmatie (1411-1420). Florence, qui a connu une grave
crise bancaire entre 1342 et 1346, puis comme toute la péninsule, les méfaits de
la peste noire de 1348, se relève à la fin du siècle. Le gouvernement, mené par
l’oligarchie marchande, doit affronter la révolte sociale des Ciompi en 1378 et
résister à la poussée des Visconti. Elle annexe Arezzo, Livourne et Pise, sa
rivale de toujours (1406). Florence domine ainsi toute la vallée de l’Arno.
Le départ des papes pour Avignon a laissé les États de l’Église
dans une complète anarchie. De petites seigneuries s’y constituent; à Rome même,
Cola di Rienzo, s’inspirant de souvenirs antiques, veut régénérer l’Italie en
lui donnant un empereur national. L’aventure échoue, et la ville reste déchirée
par les luttes entre grandes familles. Le cardinal Albornoz nettoie l’État
pontifical des bandes de mercenaires, et rétablit l’ordre pour préparer le
retour du pape à Rome. L’événement, qui interfère avec le conflit
franco-anglais, provoque le Grand Schisme et la dislocation de l’Italie centrale
(1378).
L’état territorial vers 1450
Au début du XVe siècle, l’Italie est un
agrégat de villes menacées dans leur indépendance, de royaumes sans vrai roi, de
seigneuries se transformant en principautés. L’ambition d’un prince se heurte
aussitôt à la coalition de ses adversaires groupés en ligues, aussi changeantes
que les idéaux de ses chefs, les condottieri Facino Cane, Colleoni ou François
Sforza. Le jeu politique consiste donc à transformer une instabilité chaotique
en un fragile équilibre, atteint au moment de la paix de Lodi (1454), et
difficilement préservé pendant trois décennies.
Entre-temps, la papauté réunifiée a regagné Rome, mais n’a
plus de politique proprement italienne. Elle rétablit son autorité sur la ville,
au détriment de l’aristocratie romaine (1435-1438). En Italie du Sud, les
malheurs de Jeanne II conduisent Alphonse d’Aragon, vaincu à Ponza, mais soutenu
par Philippe-Marie Visconti, à s’emparer de Naples que lui dispute vainement le
« roi » René, aidé par les autres puissances italiennes coalisées. Ainsi est
rétablie l’unité du Midi italien, mais au profit d’une dynastie étrangère.
En Italie du Nord, Florence et Venise, tout en se
surveillant, s’allient contre Philippe-Marie Visconti; mais les succès de la
Sérénissime conduisent François Sforza, devenu duc de Milan en 1450, à changer
de camp et à se tourner vers Florence où, depuis 1434, Côme de Médicis a
transformé la république oligarchique en un principat de fait qu’illustre son
petit-fils, Laurent le Magnifique (1469-1492). L’équilibre territorial,
sanctionné par la paix de Lodi et par la conclusion d’une « très sainte ligue »,
résiste aux intrigues provoquées par la conjuration des Pazzi contre les Médicis
(1478) et aux ambitions de Venise lors de la guerre de Ferrare (1482). Il est
remis en cause lorsque les affaires de Naples et l’alliance de Ludovic le More
poussent Charles VIII à revendiquer personnellement l’héritage angevin en
Italie. L’appel à l’aide étrangère de princes italiens rivaux et dépourvus du
moindre idéal national n’a pas peu contribué à faire de la péninsule le champ
des affrontements dynastiques entre la France, l’Aragon et la maison d’Autriche.
L’économie
La prospérité de l’Italie, l’éclat de sa
civilisation attisent aussi les convoitises étrangères. L’avance économique de
l’Italie s’est maintenue aux XIVe et XVe siècles, mais non sans heurts. Le
contraste s’est accentué entre le Nord et le Sud. Ici, l’accaparement des
sources de richesse par les étrangers – Aragonais, Vénitiens, Florentins – a
empêché la formation d’une bourgeoisie nombreuse. Les guerres incessantes ont
désolé les campagnes qu’une paysannerie asservie aux caprices d’un baronnage
tout-puissant n’est guère portée à bien mettre en valeur. L’appauvrissement du
Midi est déjà irrémédiable.
Dans le Nord, au contraire, la vie économique se relève vite
après les grandes calamités du temps, famines, épidémies, pestes. Les villages
désertés et les restrictions de l’espace cultivé sont assez rares. Les villes
lombardes et toscanes ont une industrie florissante, malgré des troubles
sociaux: draps, soieries et futaines font leur renommée. L’exploitation de
l’alun de Tolfa enrichit la Chambre apostolique et les Médicis. Les Florentins,
affaiblis par les crises de leurs compagnies commerciales du XIVe siècle, se
sont repris: les familles Alberti, Strozzi, Pazzi et surtout Médicis sont à la
tête de puissantes compagnies à filiales dont les activités fort diversifiées
couvrent tout l’Occident. Grâce à elles, les techniques financières et bancaires
s’affinent: la comptabilité à partie double, la lettre de change, le chèque,
l’assurance maritime deviennent d’un usage courant. Gênes et Venise, affaiblies
par leurs rivalités en Orient où l’avance turque fait progressivement
disparaître leurs comptoirs, continuent de commercer de la mer Noire aux pays
riverains de la mer du Nord; dans ces échanges, les matières premières et les
denrées alimentaires tendent à l’emporter sur les produits de luxe. Fortement
implantés en Occident – surtout dans la péninsule Ibérique où certains, tel
Christophe Colomb, servent les rois conquérants –, Génois et Vénitiens y
exercent une domination financière qui leur permet de survivre au déclin du
commerce oriental à la fin du XVe siècle.
Vers la Renaissance: une nouvelle culture
Les succès des princes, l’enrichissement
des bourgeois transforment profondément les modes de vie et de pensée. La
réussite des condottieri, des papes ou des seigneurs exalte la force et la
valeur des individus que leur virtù , fruit de leur volonté et de la chance,
place au-dessus du commun. Les prédications évangéliques des Franciscains, le
mysticisme de Savonarole et les mortifications des flagellants semblent
anachroniques. Le morcellement politique de l’Italie pousse les intellectuels à
rêver d’une patrie italienne fondée sur des souvenirs antiques, mais aussi à
célébrer la gloire des princes qui leur assurent de quoi vivre. Une langue et
une culture communes fondées sur l’étude des classiques, la grandeur de Rome, le
culte de l’Antiquité ravivé par les émigrés byzantins après 1453 se répandent.
Pétrarque et Boccace annoncent les humanistes du XVe siècle, qui, dans les
sciences, les arts ou les lettres, goûtent la vie pour elle-même et célèbrent la
valeur de l’homme, maître de son destin. Ils jouent souvent, tels Enea Silvio
Piccolomini ou Laurent le Magnifique, un rôle politique ou économique
remarquable. Depuis Rome, Florence, Venise, Milan, Palerme ou Bologne, ils
diffusent la culture antique dans tout l’Occident.
Ainsi, l’Italie à la fin du XVe siècle est un ferment de
renaissance pour toute l’Europe. Le droit romain, enseigné à Bologne, a renforcé
les monarchies. Marchands et banquiers italiens ont donné une forte impulsion à
l’économie européenne, et ont résisté à la grande dépression des XIVe et XVe
siècles. Artistes et humanistes célèbrent l’idéal de Rome et la supériorité de
la péninsule sur les « Barbares ». Il n’est pas étonnant que, fascinés par le
mirage italien, ceux-ci aient voulu profiter de la richesse du pays et
satisfaire leurs ambitions territoriales. L’Italie, divisée et « abandonnée aux
caprices de chacun » (Dante), devient avec la Renaissance une école de vie et de
pensée pour toute l’Europe.
12. De la Renaissance à l’ère des Lumières
Entre le XIIIe et le XVe siècle, la péninsule italienne est l’un des principaux foyers de l’activité économique européenne. Organisée tout d’abord autour des communes, la vie politique suscite la naissance d’États régionaux. Les deux forces antagonistes, Empire germanique et papauté, qui avaient jusque-là dominé, renoncent à assurer leur prépondérance. De 1454 à 1494, une « politique d’équilibre » groupe les souverains dans une Ligue italienne qui, dans le climat culturel et artistique prestigieux du Rinascimento , semble préfigurer la formation d’un État national, sur le modèle espagnol ou français. Mais une série d’interventions étrangères vont bloquer cette évolution et retarder jusqu’au XIXe l’accomplissement du processus unitaire.
L’échec de la tentative française et l’hégémonie espagnole
Dans la première moitié du XVIe siècle, la politique européenne est dominée par la rivalité des grandes puissances pour le contrôle d’une Italie prospère, mais morcelée. Née d’un antagonisme franco-espagnol, la lutte s’élargit aux dimensions d’un conflit européen et se complique par l’incidence des bouleversements profonds que sont la découverte du Nouveau Monde et la Réforme. Elle se déroule sur un fond très complexe d’intrigues et d’alliances conclues et dénouées. Jusqu’en 1516 se succèdent les « descentes » françaises en Italie, pays qui exerce sur les Valois une fascination où se mêlent le goût de l’aventure, le mythe méditerranéen et la réminiscence des croisades. En septembre 1494, Charles VIII fait une promenade militaire jusqu’à Naples, où il revendique la succession des princes d’Anjou. Il s’y fait couronner « roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem ». Mais l’Espagne et les autres États italiens, inquiets de ce triomphe, suscitent une coalition antifrançaise. Charles VIII doit regagner la France, et il se fraye le passage des Alpes par la difficile victoire de Fornoue (Fornovo), le 6 juillet 1495. Louis XII relance la lutte. Au printemps 1500, il s’empare facilement du Milanais et, dans l’été 1501, du royaume de Naples. Mais l’Espagne, qui possède la Sicile, ne peut tolérer cette présence française. Loin de leurs bases, les Français résistent pendant deux ans puis, en dépit de la valeur de Bayard, vaincus au Garigliano, ils doivent, en 1504, abandonner Naples à l’Espagne. Le pape Jules II, appuyé par Venise et l’Espagne, suscite la formation d’une Sainte Ligue pour chasser les « barbares » français. Malgré la sanglante victoire de Gaston de Foix à Ravenne (11 avr. 1512), Louis XII doit renoncer également au Milanais. Son successeur, François Ier, tente la reconquête de Milan. Il l’obtient en battant les coalisés et leurs alliés, les mercenaires suisses, à Marignan (actuellement Melegnano), les 13 et 14 septembre 1515. La paix de Noyon (13 août 1516) laisse le Milanais à François Ier, Naples à l’Espagne, tandis que les Suisses se retirent de la lutte et signent avec la France la « paix perpétuelle ».
La victoire espagnole
Les guerres d’Italie rebondissent avec
l’élection impériale de 1519, où Charles de Habsbourg triomphe de François Ier.
Charles Ier, devenu Charles Quint, qui a joint aux possessions espagnoles les
terres des Habsbourg d’Autriche, encercle dangereusement la France et attaque le
Milanais. François Ier est battu à Pavie (24 févr. 1525) et emmené en captivité.
Il doit souscrire en 1526 au traité de Madrid, par lequel il renonce à Naples et
au Milanais. Après sa libération, il se rapproche de l’Angleterre, des Turcs et
des protestants allemands, tandis que, par la ligue de Cognac, il s’allie aux
principaux princes italiens. En 1527, Rome est saccagée par les Austro-Espagnols
et, en 1530, Charles Quint est couronné empereur par le pape. De 1530 à 1559, la
suprématie espagnole va se consolider. Le conflit entre maison de France et
maison de Habsbourg s’élargit en une guerre d’usure, étendue au continent,
aggravée par les difficultés financières des belligérants, la crise de la
Réforme en Allemagne et l’entrée en lice de la puissance turque. François Ier
reprend l’offensive en 1536, occupant la Savoie et le Piémont et attaquant le
Milanais. L’Italie, enjeu de la lutte, n’est point cependant le terrain
principal des opérations, et les deux antagonistes s’y affrontent dans un jeu
diplomatique serré, jalonné de coups d’État et de conjurations fomentés dans les
États de la péninsule. Henri II, monté sur le trône en 1547, est soumis à une
forte pression pour rouvrir la guerre en Italie de la part de sa femme,
Catherine de Médicis, nièce du pape Clément VII, et des émigrés, mercenaires ou
financiers florentins qui contrôlent la Banque de Lyon. La dernière phase du
conflit se déroule hors de la péninsule. La France contient la puissance de
Charles Quint qui doit lui concéder, en 1552, la possession des Trois-Évêchés de
Metz, Toul et Verdun. Charles Quint abdique, en 1556, et son pouvoir est partagé
entre son fils, Philipe II, qui règne en Espagne, en Flandre, à Milan, à Naples
et en Sardaigne, et son frère, Ferdinand, empereur d’Autriche.
Emmanuel-Philibert de Savoie, qui commande les troupes impériales, est vainqueur
à Saint-Quentin, en 1557. L’épuisement des belligérants conduit à la signature
de la paix du Cateau-Cambrésis, entre la France et l’Espagne, le 3 avril 1559.
Ce traité est un tournant capital dans l’histoire de
l’Italie: le duc de Savoie recouvre ses États et, moyennant la possession
confirmée des Trois-Évêchés, la France renonce définitivement à ses prétentions
sur la péninsule, qui est livrée sans partage à l’hégémonie espagnole. Les
tentatives françaises de dominer l’Italie se soldent, politiquement, par un
échec complet. En revanche, dans le domaine des arts, elles auront une influence
considérable en ouvrant le royaume aux courants de la Renaissance. En effet,
c’est dans la seconde moitié du XVIe siècle, alors que l’Italie est déchirée par
les guerres et les rivalités politiques, que se situe l’apogée du Rinascimento.
Le toscan s’affirme comme langue littéraire avec l’Arioste, le Tasse et les
écrivains politiques Machiavel et Guichardin; le génie de Bramante, de Raphaël,
de Michel-Ange, de Léonard de Vinci et des autres artistes des deux grandes
écoles, vénitienne et florentine, produit des chefs-d’œuvre dans l’architecture,
la sculpture et la peinture. La domination espagnole agit par le contrôle
militaire de la péninsule et par les armes spirituelles de l’Inquisition et de
la Contre-Réforme. Dans un climat de conformisme religieux qui persécute les
esprits libres, comme Galilée, fleurit l’art baroque. Églises et palais dessinés
par Bernin, Borromini et leurs émules s’édifient à Rome et dans les grandes
métropoles régionales. Jusqu’en 1598, l’Espagne exerce une tutelle étroite sur
une Italie dont le découpage politique ne varie pratiquement pas, jusqu’en 1713.
Dans la seconde phase, qui va jusqu’en 1618, les princes tentent d’atténuer
cette dépendance en recherchant l’appui de la France. Tandis que Venise et les
républiques maritimes amorcent un déclin, un État jusque-là secondaire, le duché
de Savoie, commence son ascension. L’ambitieux duc Charles-Emmanuel Ier dispute
à la France la succession de Mantoue et du Montferrat. Après son échec dans sa
tentative de reconquérir Genève, passée à la Réforme, il acquiert de Henri IV le
marquisat de Saluces, sur le versant piémontais des Alpes, mais lui cède, au
traité de Lyon (17 janv. 1601) la Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de
Gex, et doit reconnaître l’indépendance de Genève. Désormais, c’est vers
l’Italie que se tournent les visées de la dynastie de Savoie, tandis que
s’esquisse la formation d’une frontière franco-italienne à la crête des Alpes.
La péninsule est au centre de l’action anti-espagnole de Richelieu. Il obtient
pour le duc de Nevers l’héritage de Mantoue, et reçoit du duc de Savoie
Pignerol, aux portes de Turin, tandis qu’il tente de contrôler la vallée
stratégique de la Valteline, qui joint l’Italie du Nord à l’Empire autrichien.
Le siècle de Louis XIV voit l’effacement de la prépondérance espagnole au profit
de la France. Les liens de famille font de Turin un satellite de Versailles,
sous les régences de Christine de France et de Jeanne Baptiste de Nemours. Le
roi pratique, outre-monts, une politique de prestige et de coups de force,
annexant Casale et bombardant Gênes, puis contraignant le duc de Savoie à
chasser les protestants établis dans les vallées vaudoises du Piémont. Mais le
duc Victor-Amédée II entend secouer cette pesante tutelle. Il pratique une
habile politique de bascule entre Louis XIV et ses ennemis. Allié de la France
dans la guerre de la ligue d’Augsbourg, il change de camp en 1690, ce qui lui
vaut l’invasion de la Savoie et du Piémont, et les défaites de Staffarda et de
La Marsaille (Marsaglia). En 1696, il signe la paix séparée de Turin. Il en va
de même dans la guerre de la Succession d’Espagne où Victor-Amédée II abandonne
la France, en 1703. La Savoie est réoccupée, et Turin soutient victorieusement
un long siège. L’assiette de l’Italie est remaniée aux traités d’Utrecht et de
Rastadt, en 1713. Une nouvelle carte politique se dessine, qui durera jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime. Le premier bénéficiaire est le duc de Savoie. Il étend
son domaine dans la plaine du Pô (Alexandrie, Casale, la Lomellina, la Valsesia)
et dans les Alpes, avec les vallées d’Oulx et de Fenestrelle, cédées par la
France contre Barcelonnette. Enfin, il obtient la couronne royale de Sicile,
qu’il échange, en 1718, contre celle de Sardaigne. Sur le plan international, le
résultat majeur est le remplacement de la domination espagnole par l’hégémonie
autrichienne: l’empereur acquiert le Milanais, Mantoue, Naples et la Sardaigne.
Mais depuis la fin des guerres d’Italie, la péninsule est
sortie du champ de la politique européenne. Elle n’évolue plus qu’en fonction
des grandes puissances. Ce rôle marginal va de pair avec un déclin économique,
conséquence des découvertes maritimes et de la suprématie de l’Atlantique sur
une Méditerranée fermée et, de surcroît, rétrécie par l’avancée des Turcs. Cet
effacement économique s’opère graduellement. Jusqu’au début du XVIIe siècle, la
prospérité demeure, et la péninsule est le centre de redistribution en Europe de
l’or espagnol du Nouveau Monde, le fournisseur de denrées de luxe du continent.
Mais cet essor se ralentit avec l’éclipse de la monarchie ibérique et la
récession qui frappe Venise et Gênes. Défavorisée par son climat trop sec et la
médiocrité de ses ressources naturelles, l’Italie ne participe que très
modestement à la nouvelle économie du capitalisme bourgeois. La vie sociale se
replie sur elle-même, dans des rapports ville-campagne fondés sur la rente
foncière, la prépondérance de l’agriculture de subsistance et l’artisanat de
qualité. La population régresse de 12 millions, vers 1500, à 11 millions, vers
1600; elle atteint seulement 11,3 millions d’habitants en 1700, dans un climat
sombre d’épidémies, de paupérisme, de délinquance, qui contraste avec la façade
somptueuse de l’urbanisme baroque.
L’hégémonie autrichienne
Le XVIIIe siècle italien est une période
calme au cours de laquelle passent au premier plan les phénomènes
socio-économiques et la politique intérieure des États. Jusqu’en 1748, la
péninsule est intéressée par les ultimes épisodes de la lutte entre les Bourbons
et les Habsbourg. Au terme de la guerre de la Succession de Pologne, l’alliance
de la Sardaigne avec la France et l’Espagne, contre l’Autriche, vaut à
Charles-Emmanuel III, en 1738, quelques agrandissements, aux dépens du Milanais.
Mais Vienne resserre son emprise avec l’acquisition des duchés de Parme et
Plaisance puis, à l’extinction des Médicis, l’installation des HabsbourgLorraine
sur le trône grand-ducal de Toscane. De son côté, l’Espagne reprend pied dans le
Midi, avec le retour des Bourbons – rapidement italianisés – dans le royaume des
Deux-Siciles. Dans la guerre de la Succession d’Autriche, qui éclate en 1740, la
Sardaigne se range du côté de Vienne. Après des succès initiaux, les
Austro-Sardes subissent des revers, avec le soulèvement populaire de Gênes,
alliée à la France, et l’attaque du Piémont, sur les crêtes des Alpes, par les
troupes de Louis XV. Le 18 octobre 1748, la paix d’Aix-la-Chapelle sanctionne le
nouvel équilibre italien entre Bourbons et Habsbourg, qui demeurera inchangé
pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le Piémont fixe sa limite orientale
à la frontière naturelle du Tessin, et les Bourbons d’Espagne obtiennent les
duchés de Parme, Plaisance et Guastalla.
Un vigoureux essor démographique porte la population à 16,5
millions d’âmes, en 1770. Dans l’élite intellectuelle de la bourgeoisie citadine
et de l’aristocratie se développe une brillante culture, à la fois originale et
perméable aux influences européennes. Elle incarne la facilité et la douceur de
la vie, dans les fêtes du carnaval de Venise, les comédies de Goldoni, la
musique de concert ou d’opéra-bouffe de Scarlatti, Pergolèse et Cimarosa, les
paysages vénitiens de Canaletto, Longhi ou Tiepolo. Mais à côté de savants,
comme Volta ou Spallanzani, l’élément le plus original est l’école
philosophico-juridique des Lumières (Illuminismo ). Elle vise à appliquer la
raison à l’art de gouverner et à l’économie en libérant l’État de la
prépondérance de l’Église et en incitant les princes à prendre l’initiative des
réformes. Philosophes de l’histoire, comme G. B. Vico, économistes libéraux,
influencés par les encyclopédistes et les physiocrates, les intellectuels
collaborent avec les souverains dans des expériences de despotisme éclairé. Plus
autoritaire et absolutiste en Piémont, plus administratif et économique dans le
royaume de Naples, le réformisme du Settecento enregistre ses principales
réussites dans l’Italie centrale, à Parme et en Toscane. La législation est
amendée dans un sens humanitaire, la peine de mort abolie, l’administration
rendue plus exacte et plus équitable, l’agriculture modernisée. Il semble que le
despotisme éclairé ait résolu la crise de l’Ancien Régime. En fait, derrière ces
apparences favorables, le bilan est largement négatif. Les réformes ne modifient
pas en profondeur la société et l’économie, et n’augmentent pas les ressources
en fonction de l’accroissement démographique. La condition des paysans et des
petites gens se détériore, et ils ressentent plus durement leur dépendance
envers les grands propriétaires fonciers, bourgeois du Centre et du Nord, ou
aristocrates latifundiaires du Mezzogiorno . Dans une Europe où la révolution
industrielle produit ses premiers bouleversements, l’Italie demeure une zone
d’archaïsme et d’immobilisme. Un désir de changement est ressenti obscurément
dans les masses et, plus explicitement, dans les élites libérales. Avec Vittorio
Alfieri, elles rêvent d’une Italie régénérée, maîtresse de son destin, libérée
de la tutelle étrangère et assumant une conscience nationale.
13. Le Risorgimento et l’unité
La lente conquête de l’indépendance demandera trois quarts de siècle, et, en dépit des aspirations et des complots des patriotes, elle ne sera possible qu’avec l’aide militaire et diplomatique de la France et l’appui de l’Angleterre.
L’Italie républicaine et jacobine
La force de rupture de l’ordre ancien vient de la Révolution française. Les idées de 1789 suscitent, dans la bourgeoisie, des sympathies qui se traduisent par une sourde opposition aux souverains, rangés dans le camp antifrançais. En 1791, la Constituante annexe l’enclave pontificale du Comtat-Venaissin. En 1792, Victor-Amédée III de Savoie s’allie à l’Autriche. La Savoie et le comté de Nice sont envahis et annexés à la France après plébiscite. L’offensive de la « grande nation » se développe au printemps 1796. Après une fulgurante campagne, la victoire de Lodi ouvre la Lombardie à Bonaparte qui impose au Piémont, occupé, un traité signé à Paris, le 15 mai 1796. Il lui faudra cinq mois de durs combats autour de Mantoue (Bassano, Arcole, Rivoli), de septembre 1796 à janvier 1797, pour forcer la route de Vienne et imposer à l’Autriche les préliminaires de Leoben (7 avr.) confirmés par la paix de Campoformio (18 oct. 1797). L’empereur cède au Directoire la Lombardie et reçoit en compensation les terres de la république de Venise. Dans toute l’Italie, l’Ancien Régime s’écroule, sous la double poussée des armées françaises et de l’action des jacobins locaux. Une floraison de « républiques sœurs » adopte les institutions politiques et la législation nées de la Révolution. Le pouvoir passe à la bourgeoisie des propriétaires, la féodalité est abolie, les biens d’Église mis en vente. Bonaparte crée en Lombardie la république Cisalpine (26 juin 1797), qui absorbe l’éphémère république Cispadane , formée en Émilie et à Modène et qui s’était donné comme emblème le tricolore vert-blanc-rouge. Gênes s’érige en république Ligurienne (2 déc. 1797). Les Français occupent Rome et proclament la république Romaine (févr. 1798). Le roi de Naples perd ses États continentaux, où naît la république Parthénopéenne (23 janv. 1799), et se réfugie en Sicile. Dès décembre 1799, le Piémont est annexé à la France. Cette Italie jacobine s’effondre devant les succès de l’offensive austro-russe qui, de mars à août 1799, réoccupe la péninsule, sur laquelle s’abat la réaction.
L’Italie napoléonienne
Bonaparte, qui s’est emparé du pouvoir par le coup d’État du 18 brumaire (9-10 nov. 1799), redresse la situation. La victoire de Marengo (14 juin 1800) et la paix de Lunéville (9 févr. 1801) replacent l’Italie sous l’hégémonie française. Durant le Consulat, puis l’Empire, Napoléon, qui n’a pas de politique italienne préméditée, va opérer, au gré des circonstances, des remaniements autoritaires successifs. Ils aboutissent à une intégration au système continental français et à une extension du gouvernement direct, soit par le moyen d’annexions à l’Empire, soit par la création d’États vassaux, donnés à des membres de la famille Bonaparte. À l’image de la métropole, les institutions des anciennes républiques le cèdent au césarisme bureaucratique et centralisateur. En décembre 1801, les notables de la Cisalpine, réunis dans la Consulta de Lyon, créent une République italienne dont Napoléon est élu président. Le 31 mars 1805, elle est transformée en royaume d’Italie, dont l’Empereur ceint la couronne et qu’administre le vice-roi Eugène de Beauharnais. Dans un premier temps, le pape et le roi de Naples conservent leurs États, et la Toscane devient un royaume d’Étrurie , donné au duc de Parme. Après Austerlitz et la victoire sur la troisième coalition, puis à cause des nécessités du Blocus continental, l’emprise française se resserre sur l’Italie, dans le cadre du « système familial ». La Vénétie est annexée au royaume d’Italie, ainsi que Parme, Plaisance et Gênes. Élisa Bonaparte règne à Lucques et Piombino; Pauline à Guastalla. Le roi de Naples est chassé de son trône, octroyé en 1806 à Joseph Bonaparte, puis, en 1808, à Joachim Murat. L’Étrurie est attribuée, en 1809, à Élisa sous le nom de grand-duché de Toscane. L’Empire annexe le Trentin et le littoral dalmate, en 1809. L’Italie du Nord et du Centre est découpée en départements, sur le modèle français. Seules la Sicile et la Sardaigne échappent à la tutelle française. Cette Italie napoléonienne est entraînée dans l’écroulement de l’Empire, en 1814. Murat, qui s’est séparé de Napoléon, conserve son royaume. Après Waterloo, il doit abdiquer; il tente un débarquement pour reprendre son trône, mais il est pris et fusillé (13 oct. 1815). Le Congrès de Vienne rétablit l’Italie d’Ancien Régime, en vertu du principe de légitimité. Il semble donc que la période révolutionnaire et impériale se solde par un échec total. En fait, la présence française a laissé des traces profondes. Elle a associé la péninsule à un destin européen et, en dépit de la tutelle impériale, donné aux Italiens l’occasion d’une première expérience de vie nationale commune.
La Restauration: faillite des révolutions romantiques
Pour Metternich, l’Italie n’existe plus
comme entité politique. Ce n’est qu’une « expression géographique ». En fait,
c’est une nouvelle hégémonie autrichienne qui est rétablie. En dehors de la
Sardaigne, qui conserve Gênes, des États du pape et du royaume de Naples,
étroitement alignés sur Vienne, l’Autriche gouverne directement dans le Royaume
lombardo-vénitien, ou par l’intermédiaire de membres de la dynastie impériale en
Toscane, à Modène, et, avec Marie-Louise, épouse de Napoléon, à Parme. À
l’absolutisme restauré s’oppose une minorité de libéraux, bourgeois et prêtres
cultivés, anciens officiers, souvent affiliés à la Maçonnerie ou à la
Charbonnerie. Ces patriotes, imbus d’un idéal romantique, veulent voir «
resurgir » (Risorgimento ) la nation italienne. Ils opèrent sans plan
d’ensemble, par des conspirations ou des séditions militaires, vite étouffées
par les forces de la réaction. En 1821, des révolutions, avortées éclatent à
Naples et en Piémont. Dans le Lombard-Vénitien, la police réprime durement de
nombreux complots, et les « martyrs » – comme Silvio Pellico – emplissent les
cachots. La révolution française de juillet 1830 suscite une nouvelle flambée de
mouvements, tous voués à l’échec. De 1831 à 1846, l’initiative passe à Giuseppe
Mazzini et à ses amis, adeptes d’une République unitaire, démocratique et
déiste, qu’ils veulent instaurer par des soulèvements populaires. Leurs
tentatives ne rencontrent guère d’écho dans les masses, et sont rapidement
écrasées. La crise de 1848 marque la fin des révolutions romantiques.
Le Quarantotto italien, à la fois le plus précoce et le plus
tardif des mouvements européens du « printemps des peuples », est un déroulement
très complexe d’épisodes où se mêlent une poussée de libéralisme politique, une
croisade nationale pour l’indépendance et une revendication sociale des masses.
C’est sans doute aussi le seul des grands moments du Risorgimento auquel aient
participé activement des éléments populaires. La phase montante commence dès
1846, avec les velléités libérales du pape Pie IX qui, selon les vœux des
néo-guelfes, semble vouloir prendre la tête de la régénération. L’Italie est la
proie d’une agitation qui incite les souverains à faire des concessions
libérales. La révolution parisienne de février 1848 précipite le mouvement qui
est facilité par les embarras de l’Autriche, elle-même aux prises avec l’émeute
à Vienne. Venise et Milan se soulèvent (18-23 mars); des gouvernements
provisoires se forment à Parme, Modène, Reggio nell’Emilia, Plaisance, tandis
que des constitutions sont promulguées à Florence (7 févr.), Naples (10 févr.),
Turin (5 mars), Rome (14 mars). Le 24 mars, le roi de Sardaigne, Charles-Albert,
prend la tête de la guerre d’Indépendance, à laquelle participent des troupes
des autres États, après avoir refusé l’aide de la IIe République française (L’Italia
farà da sé ). L’action s’engage dans l’équivoque, car CharlesAlbert poursuit les
buts traditionnels d’agrandissement territorial du Piémont beaucoup plus qu’un
idéal unitaire. L’offensive enregistre des succès en avril (Goito, Pastrengo)
puis piétine devant Mantoue. Dès la fin d’avril 1848, la ferveur nationale
retombe. Pie IX, effrayé par l’ampleur des révolutions, se retire de la lutte
italienne, brisant le mythe néo-guelfe d’un pontife chef et arbitre d’une
péninsule libérée. Il rappelle ses troupes, imité par Ferdinand II de Sicile
qui, en mai, dissout le Parlement de Naples, puis réprime par le canon la
sécession de la Sicile. En juillet, l’Autriche, qui a maîtrisé sa révolution,
entame la reconquête de l’Italie, désormais incertaine et divisée. Radetzky bat
Charles-Albert à Custoza (25 juill.) et, après avoir repris Milan, lui impose un
armistice. Alors que les autres révolutions européennes déclinent et meurent, le
Quarantotto se prolonge, avec un caractère nouveau: une violente poussée
républicaine et démocratique. Pie IX, désormais revenu à un farouche
conservatisme, quitte Rome et se réfugie à Gaète, sous la protection du roi de
Sicile. Il laisse le champ libre aux mazziniens qui, le 9 février 1849,
proclament l’abolition du pouvoir temporel et la République romaine. Le 27
octobre, la république est également instaurée en Toscane. En Ligurie, où Gênes
se révolte, les démocrates gouvernent, dans un climat très agité de polémiques,
de crise économique et d’instabilité ministérielle. À l’abbé Vincenzo Gioberti
succède Urbano Rattazzi, qui réclame la reprise de la guerre. Charles-Albert s’y
résigne, malgré l’impréparation matérielle et morale du pays. Au bout de six
jours de campagne, les Piémontais sont écrasés à Novare (23 mars 1849). Le roi
abdique immédiatement, et laisse la couronne à son fils, Victor-Emmanuel II, qui
signe avec l’Autriche une paix aux conditions rigoureuses. La IIe République,
conservatrice, intervient en faveur du pape; après une longue action
diplomatique et militaire, Louis-Napoléon Bonaparte presse les troupes
françaises d’entrer dans la Ville éternelle, qu’elles occupent le 4 juin. À
Venise, Daniele Manin capitule, le 22 mai. Partout triomphe la réaction, sous
l’égide de l’Autriche. Seul le Piémont conserve sa constitution et apparaît
désormais comme l’unique espoir des patriotes.
L’ère des modérés: Cavour et la formation du royaume d’Italie
La bourgeoisie d’affaires se rallie à la solution piémontaise. Son idéal s’incarne en Camille Benso di Cavour, ministre en 1850, puis président du Conseil. Il s’agit de créer, sur la base d’intérêts économiques communs, une conscience nationale, de permettre au « pays légal » de gérer la chose publique dans une ligne de juste milieu, de rassurer l’Europe et de faire admettre l’Italie dans le concert des nations. Massimo d’Azeglio amorce la convalescence du Piémont, et, au cours de la « décennie de préparation » (1849-1859), l’accent est mis sur la rénovation intérieure. Cavour stimule l’économie par le libre-échange et l’équipement ferroviaire. Il réalise, non sans se heurter à une violente opposition, la laïcisation partielle de l’État, et modernise l’armée. Le Piémont participe à la guerre de Crimée (1855), ce qui lui permet de poser la question italienne au Congrès de Paris et de revendiquer pour la péninsule l’application du principe des nationalités. Mais la lutte contre l’Autriche n’est possible qu’avec un puissant concours militaire étranger. Il est offert par Napoléon III qui, par son passé de carbonaro et ses affinités, nourrit une active sympathie pour le Risorgimento. Le 21 juillet 1858, à Plombières, il ébauche, avec Cavour, un plan de réorganisation fédérale d’une Italie partagée entre le Piémont, le pape et le royaume de Naples. Pour prix de son aide, la France recevra la Savoie et Nice. L’alliance franco-sarde aboutit à la guerre contre l’Autriche, marquée par les sanglantes victoires de Magenta (4 juin 1859) et de Solferino-San Martino (24 juin). Mais l’empereur, suivi avec réticence par l’opinion française et craignant une intervention prussienne, arrête brusquement la campagne. Cavour démissionne, et le Piémont reçoit la Lombardie. Les agents de la Società nazionale italiana (Société nationale italienne), soutenus en sous-main par Cavour, suscitent une flambée de mouvements révolutionnaires dans les duchés de l’Italie centrale et dans les légations pontificales, qui demandent leur union au Piémont (avril-juin 1859). En janvier 1860, Cavour revient au pouvoir et obtient l’acquiescement français à ces annexions en cédant à Napoléon III la Savoie et Nice, au traité de Turin (24 mars 1860). Giuseppe Garibaldi, ancien mazzinien aventureux, débarque en Sicile le 11 mai avec l’expédition des Mille, occupe l’île et entend instaurer un régime démocratique, opérant des réformes sociales. L’Europe s’alarme, et Cavour, d’abord complice, risque d’être débordé. Le 7 septembre 1860, Garibaldi entre à Naples. Cavour, avec l’accord de la France, fait avancer dans les États pontificaux des troupes qui occupent et annexent les Marches et l’Ombrie, après avoir dispersé les troupes de Pie IX à Castelfidardo (18 sept.). L’épreuve de force avec Garibaldi est évitée, et le condottiere s’efface devant Victor-Emmanuel II. Le 5 novembre, le royaume de Naples est annexé, après plébiscite. Le 27 avril, un Parlement national proclame, à Turin, le souverain piémontais roi d’Italie. Le 6 juin, Cavour meurt brusquement, à cinquante et un ans.
L’achèvement de l’unité
Après la marche rapide du Risorgimento, entre 1859 et 1861, le mouvement unitaire, privé de son guide, se ralentit et piétine. La fusion des nouvelles provinces au Piémont est laborieuse; les mentalités se heurtent, et la crise financière est aiguë. Dans le Midi sévit le brigandage, né du mécontentement paysan devant l’administration des gens du Nord et encouragé par les partisans des Bourbons déchus. La France bloque la question romaine, irritant grandement les patriotes. Garibaldi tente un coup de main contre Rome, et est arrêté par les troupes royales, à l’Aspromonte (29 août 1862). Napoléon III, qui demeure résolu à aider l’Italie, négocie avec Marco Minghetti la convention du 15 septembre 1864, par laquelle il s’engage à évacuer Rome, moyennant le transfert de la capitale à Florence et le respect de l’intégrité du territoire pontifical. En 1865, il s’entremet avec Bismarck pour faire conclure une alliance entre la Prusse et le Piémont, contre l’Autriche. Mais les Italiens sont battus sur terre à Custoza (24 juin 1866) et, sur mer, à Lissa (20 juill.). La victoire prussienne de Sadowa leur vaut d’obtenir, au traité de Vienne, la Vénétie, annexée après le plébiscite des 21 et 22 octobre. En 1867, Garibaldi, avec la complicité occulte de Rattazzi, attaque à nouveau Rome, suscitant une violente réaction de Napoléon III. Le chef des Chemises rouges est battu à Mentana (3 nov.), et les Français réoccupent la Ville éternelle. L’achèvement de l’unité – moins Trente et Trieste – sera obtenu par le contrecoup de la guerre franco-prussienne. L’Italie dénonce la convention de septembre et, après les défaites de l’armée impériale et le rappel du corps d’occupation, les soldats de Victor-Emmanuel II, après avoir ouvert une brèche dans l’enceinte de Rome, entrent dans la ville qui est annexée, après plébiscite, le 2 octobre, et proclamée capitale du royaume.
14. La monarchie libérale
Les années difficiles
Le jeune royaume unitaire aspire à jouer
un rôle de grande puissance, mais il souffre de lourds handicaps. La médiocrité
de ses ressources minières et énergétiques ne lui permet pas de participer à la
révolution industrielle, fondée sur la houille et la vapeur. Condamné à une
économie essentiellement agricole, il dépend très largement de l’étranger pour
ses crédits et ses fournitures d’équipement, en dépit d’un lent « décollage »
industriel. Dans le domaine politique et social, la coupure s’agrandit entre le
Mezzogiorno, encore féodal, et le Nord, qui se rapproche des pays développés.
L’analphabétisme (74 p. 100 en 1861), l’étroitesse du suffrage censitaire (2 p.
100 de la population totale) mettent la vie politique aux mains d’une minorité,
accessible à la corruption, et encore réduite par le veto pontifical interdisant
aux catholiques de briguer des mandats parlementaires. Pie IX, qui a refusé la
loi des Garanties, maintient ouverte la question romaine. La « droite historique
» des successeurs de Cavour perd le pouvoir, le 18 mars 1876. Elle laisse la
place à la gauche, formée d’anciens mazziniens et garibaldiens, fortement
anticléricaux, ralliés à la monarchie. Elle prend le contrepied de la ligne
francophile et libre-échangiste de Cavour, restaurant, dès 1878, le
protectionnisme douanier et, après l’occupation française de Tunis, adhérant à
la Triplice aux côtés de l’Allemagne et de l’Autriche (20 mai 1882). Ce
rapprochement avec Vienne impose de mettre une sourdine aux revendications des «
irrédentistes », réclamant Trente et Trieste. De 1878 à 1887, Agostino Depretis
gouverne en appliquant la tactique du trasformismo (« transformisme »),
neutralisant et absorbant les oppositions par la corruption. Malgré le déficit
financier, la gauche met en train un coûteux programme d’armement.
L’augmentation démographique (26,04 millions d’habitants en 1861; 28,54 en 1875
et 31,5 en 1890) suscite les premières revendications d’expansion coloniale et,
surtout, une émigration croissante (536 000 départs en 1901). L’Italie
s’installe, sur la mer Rouge, à Assab et Massaouah, en 1885.
De 1887 à 1896, la vie politique est dominée par Francesco
Crispi. Autoritaire et impulsif, nationaliste, cet ancien mazzinien évolue vers
un conservatisme répressif, en face des progrès du socialisme qui, à partir de
1890, se diffuse largement dans les masses rurales et anime de violents
mouvements revendicatifs. L’économie traverse, de 1887 à 1896, une sévère
récession, avec l’écroulement du système bancaire et la guerre douanière avec la
France. Crispi se lance dans le colonialisme, avec la création de l’Érythrée
(1890), l’implantation en Somalie et les visées sur l’Éthiopie. Mais l’attaque
du royaume du Négus se solde par un désastre, à Adua (1er mars 1896), qui
entraîne la chute de Crispi. Les années 1898 à 1900 sont très troublées par des
émeutes sociales et de graves crises politiques qui semblent mettre en question
l’existence même de la monarchie constitutionnelle. Mais après la mort d’Humbert
Ier (1878-1900) et l’avènement de Victor-Emmanuel III, la situation se détend.
L’ère de Giolitti
À partir de 1898, l’Italie connut une expansion économique rapide, favorisée par l’abondance et le bon marché de la main-d’œuvre, et la « seconde révolution industrielle », née de l’électricité. Le textile, la mécanique automobile – la F.I.A.T. (Fabbrica italiana automobili Torino) est fondée à Turin en 1899 –, la sidérurgie progressent. Giovanni Giolitti, politicien souple et habile, administre cette relative prospérité, reprenant les méthodes du transformisme et s’assurant une majorité par la corruption et l’évolution lente vers le libéralisme. La haute conjoncture facilite cette consolidation, malgré la montée du socialisme, les outrances des nationalistes et le renforcement de la démocratie social-catholique. Entre 1901 et 1903, l’Italie se rapproche de la France, tout en demeurant dans la Triplice. En 1911-1912, Giolitti donne au pays une satisfaction d’amour-propre national, quand, au terme de la guerre contre la Turquie, le traité d’Ouchy (18 oct. 1912) sanctionne la cession de la Libye et des îles grecques du Dodécanèse. Le suffrage universel est institué en 1911 (24 p. 100 de la population totale reçoit le droit de vote) et, aux élections de 1913, les catholiques cessent de s’opposer au gouvernement. Cependant, le système giolittien se détériore, et l’Italie assiste, au début de la Grande Guerre, à une recrudescence d’agitation politique et sociale.
La Grande Guerre et la « victoire mutilée »
En 1914, comme la déclaration de guerre
est le fait de l’Allemagne, l’Italie fait jouer une clause de la Triplice
prévoyant cette éventualité, pour proclamer sa neutralité. Dans sa majorité, le
pays désire demeurer en dehors du conflit. Le gouvernement est soumis, par les
deux camps, à une intense pression diplomatique, pour l’inciter à entrer en
guerre. En face du bloc « neutraliste », animé par Giolitti, agissent les «
interventionnistes «: nationalistes, garibaldiens, milieux d’affaires. Benito
Mussolini, leader socialiste assoiffé d’action, rompt avec son parti et se
déclare partisan de la guerre. L’intervention est décidée par la politique
personnelle du roi, d’Antonio Salandra, président du Conseil, et du baron
Sonnino, ministre des Affaires étrangères. Éludant les offres de l’Autriche,
Sonnino signe avec les Alliés le pacte de Londres (26 avr. 1915) prévoyant,
contre la promesse de compensations mal définies, une entrée en guerre dans le
délai d’un mois. La décision est imposée au pays par les « radieuses journées de
mai », bruyantes manifestations de la minorité interventionniste. La lutte
commence dans l’impréparation diplomatique, militaire et économique. L’Italie
mène une guerre anti-autrichienne, de type « risorgimental », sans coordination
avec ses alliés. Le théâtre des opérations, défavorable à l’attaque, s’établit
sur les Alpes, où le front se stabilise, et en direction de Trieste, sur
l’Isonzo. Le général en chef, Luigi Cadorna, dur et obstiné, lance les
sanglantes et stériles offensives frontales des onze « batailles de l’Isonzo »
(juin 1915-sept. 1917). Dans des conditions difficiles, le pays, au prix de
sévères privations, se donne une économie de guerre et accomplit un remarquable
effort d’armement. Mais le courant neutraliste reprend vigueur en 1917, devant
les déceptions militaires et la baisse du niveau de vie de l’arrière. Le «
défaitisme » sévit dans la troupe, et dans les villes éclatent les grèves et des
manifestations de foule. Le 24 octobre, les Autrichiens percent le front par
surprise et, le 9 novembre, après une avance de cent quarante kilomètres, ils
ont refoulé les Italiens jusqu’au Piave. Au lendemain du désastre de Caporetto,
la situation est redressée, avec l’aide de renforts alliés.
Vittorio Emanuele Orlando forme un gouvernement énergique, et Armando Diaz, le
nouveau généralissime, reconstitue l’armée qui passe à l’offensive, le 24
octobre 1918. Le 3 novembre, les Autrichiens, après une tenace résistance,
malgré la désagrégation intérieure de l’Empire, signent l’armistice. L’Italie
sortait épuisée de la lutte, avec 615 000 morts, une économie désorganisée, un
déficit financier et un endettement extérieur énormes. Le congrès de la Paix
allait lui apporter des désillusions. Orlando, négociateur malhabile, se heurte
à Wilson et à Clemenceau, dans ses visées adriatiques et dans ses revendications
coloniales. Il s’entête à réclamer une application des clauses du pacte de
Londres, irréalisable dans les nouvelles circonstances internationales. Le
traité de Saint-Germain-en-Laye, avec l’Autriche (10 sept. 1919), attribue à
l’Italie Trieste et l’Istrie, et le Trentin jusqu’au col du Brenner. L’amertume
est grande, et D’Annunzio, chef de file des nationalistes, dénonce la « victoire
mutilée ». Les élections de 1919 donnent la majorité aux socialistes et aux
catholiques populaires, qui ne peuvent s’entendre sur un programme commun. Les
extrémistes se déchaînent, exploitant le mécontentement des anciens combattants,
des chômeurs et la crise économique. Le 23 mai 1919, Mussolini fonde, à Milan,
les Fasci italiani di combattimento (Faisceaux italiens de combat), groupe
nationaliste dont les débuts sont modestes. Le grand homme des patriotes est
Gabriele D’Annunzio qui, le 11 septembre 1919, s’empare de Fiume, refusée à
l’Italie, à la tête de ses légionnaires, et y installe un gouvernement. Les
socialistes, débordés par leur aile maximaliste, refusent toute coalition avec
les modérés et, en 1919 et 1920, multiplient les grèves, les occupations
d’usines, les émeutes agraires, qui effrayent les possédants. La désunion de la
majorité entrave l’œuvre de redressement diplomatique et économique du cabinet
de Francesco Saverio Nitti (juin 1919-juin 1920). Giolitti revient au pouvoir,
et son prestige lui permet de normaliser les relations avec la Yougoslavie, par
le traité de Rapallo (12 nov. 1920), de liquider par la force l’aventure de
Fiume et de mettre fin à l’occupation des fabriques. Le fascisme s’érige en
défenseur de l’ordre social, et enregistre un nombre croissant d’adhérents. Il
reçoit des subventions de la grande industrie, qui voit en lui un rempart contre
le péril rouge, et se lance à l’assaut des syndicats et des coopératives
socialistes, saccagées par les expéditions des Chemises noires. Giolitti, qui se
flatte de « normaliser » le mouvement, tolère ces désordres. Aux élections
générales de 1920, après la dissolution du Parlement, Mussolini est élu, avec
trente-cinq fascistes. Il organise un parti, tandis que la division entre
socialistes et catholiques-populaires de don Luigi Sturzo s’aggrave. La
faiblesse des gouvernements d’Ivanoè Bonomi (juill. 1921-févr. 1922) et de Luigi
Facta favorise la montée du fascisme qui, au printemps 1922, déchaîne la
violence à travers tout le pays. Devant l’abdication des forces politiques
traditionnelles, les conservateurs, les nationalistes, une partie de l’armée et
certains membres de la famille royale, comme le duc d’Aoste, se rallient à
l’idée d’un coup d’État. Au mois d’août 1922, Mussolini, qui dispose d’un vaste
réseau de complicités dans les administrations et la police, décide la marche
sur Rome. L’exécution en est confiée au « quadrumvirat » formé par De Bono,
Bianchi, Balbo et De Vecchi. Le 27, les Chemises noires convergent sur la
capitale. Le gouvernement tente de résister, mais le roi refuse l’épreuve de
force. Il entérine la capitulation de la monarchie parlementaire en offrant à
Mussolini de former un ministère. Le 31 octobre, les fascistes entrent dans
Rome.
15. L’Italie fasciste
L’organisation de la dictature
Le fascisme, qui domine la vie italienne
du ventennio 1925-1945, est une dictature antiparlementaire et antidémocratique.
Ce n’est pas une idéologie originale, mais une doctrine qui mêle, dans une
improvisation continue, l’exaltation de l’action, le culte de la force, la
subordination de l’individu à l’État, dans un système où l’autorité vient d’en
haut. La propagande et l’embrigadement des masses mettent le pays en condition.
Pourtant, le triomphe de Mussolini ne fut pas immédiat. Il fut facilité par les
déficiences de la monarchie unitaire, l’adhésion des milieux politiques et
économiques italiens, et les sympathies rencontrées à l’extérieur. Le régime
s’instaure dans les années 1922-1925. Mussolini dose habilement la modération
rassurante et la rigueur. Il forme un ministère n’excluant que les socialistes
et où les fascistes n’ont pas la majorité des portefeuilles. Mais il intimide
les députés par le menaçant « discours du bivouac », et se fait donner les
pleins pouvoirs pour un an. En janvier 1923 est créée la Milice fasciste, armée
parallèle de défense du régime, qui en couvre les exactions contre les
opposants, encore nombreux dans les milieux populaires. Le Parti fasciste
fusionne avec les nationalistes, qui lui apportent des éléments de valeur. Une
nouvelle loi attribue les deux tiers des sièges à la liste obtenant le quart des
suffrages et, aux élections d’avril 1924, le bloc nationaliste-fasciste récolte
64,9 p. 100 des voix. Pourtant un sursaut du libéralisme est encore possible,
comme en témoigne la vague d’indignation qui traverse le pays, en juin, après
l’assassinat, par les squadristes (membres de la squadra ) du leader socialiste
Giacomo Matteotti. Mais l’opposition, divisée, au lieu d’exploiter cette
circonstance, demeure inerte et commet l’erreur d’abandonner la lutte
parlementaire; le 27 juin 1924, cent vingt-sept députés se « retirent sur
l’Aventin ». Le 3 janvier 1925, Mussolini annonce le passage à la «
fascistisation » de l’État. Au terme de cette opération, le Statut
constitutionnel de 1848 ne sera plus qu’une façade derrière laquelle le Duce ,
nommé chef du gouvernement, le 24 décembre 1924, aura tous les pouvoirs. Dans
les mois qui suivent, la presse est mise au pas, l’administration épurée, les
syndicats catholiques et socialistes, et tous les partis non fascistes, dissous.
Un tribunal spécial envoie les opposants à la résidence forcée du confino .
Beaucoup d’antifascistes s’exilent et mènent à l’étranger une vie précaire.
Le régime totalitaire, interprète unique de la volonté
populaire exprimée par des plébiscites, concentre toute l’autorité dans la
personne du Duce qui gouverne, aux côtés d’un souverain réduit à un rôle
représentatif. Le parti national-fasciste fournit, à tous les degrés, les
exécutants. Le pouvoir législatif, profondément dégradé, est réduit à
l’organisme consultatif du Grand Conseil fasciste, créé en janvier 1923, au
Sénat et à la Chambre des députés. Celle-ci, ramenée à quatre cents membres en
1929, est désignée par le Grand Conseil, sur une liste nationale unique, et, en
1939, elle est transformée en une Chambre des faisceaux et corporations. Le
gouvernement édite des décrets-lois, ratifiés par une Chambre docile, et, dans
les provinces et les communes, les anciens conseils et syndics élus cèdent la
place à des représentants et des podestats nommés par le pouvoir. Le fascisme
prétend résoudre les rapports entre capital et travail par la doctrine
corporatiste, qui dépasse le marxisme. La charte du Travail (21 avr. 1927)
groupe tous les salariés dans un réseau de corporations, élaborant les contrats
collectifs de salaires et d’emploi. La législation et les codes furent refondus,
dans un sens autoritaire. En 1923, Giovanni Gentile, philosophe officiel du
régime, réforma le système scolaire et universitaire en privilégiant la culture
classique et en instituant des manuels uniques, diffusant les thèmes du
fascisme. La jeunesse fut embrigadée dans des formations paramilitaires,
Balillas et Avanguardisti , pour lui donner une formation sportive et un
endoctrinement politique.
Les succès du fascisme
La dictature, en dépit des déficiences de son personnel et de sa corruption, rencontra une large adhésion des masses jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Jamais l’opposition antifasciste, agissant par des attentats ou des démonstrations de propagande, ne menaça sérieusement le régime. Étroitement surveillée par la police politique, elle fut périodiquement décimée par des procès ou des arrestations, comme celle du théoricien marxiste Antonio Gramsci. Le pouvoir du Duce fut consolidé par les succès intérieurs et extérieurs du premier decennio fasciste (1926-1936). Par rapport à la modeste législation de l’époque giolittienne, un effort social important fut accompli, dans le domaine des retraites ouvrières, de la semaine de quarante heures, des sports, de la protection de la santé publique et de l’enfance. Une politique nataliste entraîna une augmentation de la population. Pour résorber le chômage, on mit en train un programme d’armement et de grands travaux spectaculaires: autoroutes, « bonification » des terres incultes (marais Pontins), opérations d’urbanisme. L’encadrement de l’économie par l’État évolua vers une politique « autarcique » d’autosuffisance. Mussolini refuse de dévaluer la lire, renforce le protectionnisme et livre la « bataille du blé », tandis que le tourisme apporte des devises étrangères. Un immense succès de prestige fut obtenu par la « conciliation » entre le Vatican et le royaume. Le 11 février 1929 les accords du Latran mettaient fin à la question romaine. Le pape, devenu souverain de la Cité du Vatican, reconnaissait l’État unitaire et recevait une compensation financière. Un concordat introduisait l’enseignement religieux à l’école, donnait les effets civils au mariage religieux, abolissait le divorce et accordait de nombreux avantages au clergé. Malgré des tensions passagères, dues au désir du fascisme de monopoliser la formation de la jeunesse, les relations entre la dictature et l’Église catholique demeurèrent bonnes sous les pontificats de Pie XI et Pie XII. À l’extérieur, le fascisme pratiqua une politique de collaboration internationale, réglant avec la Yougoslavie le statut de Fiume (27 janv. 1924), adhérant à la Société des Nations et s’associant à la politique de désarmement. Mussolini soutint les tendances « révisionnistes » des États danubiens mécontents des traités de 1919, mais la montée du nazisme le fit, après 1933, se rapprocher des démocraties par le Pacte à quatre (7 juin 1933). Après l’assassinat du chancelier Dolfuss par les nazis autrichiens, l’Italie mobilise sur le Brenner. Le 7 janvier 1935, les accords Laval-Mussolini accordent à l’Italie quelques avantages coloniaux, et lui laissent les mains libres en Éthiopie. À Stresa (11-14 avr. 1935), la France, l’Angleterre et l’Italie se déclarent hostiles à toute modification par la force des frontières européennes. Mais la « politique de Stresa » sombre avec l’affaire d’Éthiopie. En 1935, Mussolini attaque l’Empire du Négus, avec lequel l’Italie avait signé un traité d’amitié, en 1928. La Société des Nations condamne l’Italie et lui inflige des sanctions économiques qui demeurent largement inopérantes, et qui sont exploitées par le régime pour créer une unanimité nationale et patriotique. L’offensive décisive, partie du Tigré, au nord, et de la Somalie, au sud, en octobre 1935, aboutit, après une intense action militaire marquée par des bombardements et l’emploi des gaz toxiques, à la prise d’Addis-Abeba, le 5 mai 1936. Le 9, Victor-Emmanuel III est proclamé empereur d’Éthiopie. Cette victoire coïncide avec l’apogée du fascisme, et apporte un dérivatif aux conséquences de la grande crise économique mondiale, qui a durement frappé l’Italie, dès 1930.
Déclin et chute du fascisme
Les sanctions marquent la rupture
définitive avec les démocraties et le rapprochement avec l’Allemagne hitlérienne
et les autres dictatures qui vont s’instaurer dans le monde. Le régime se
durcit, dans une imitation du militarisme nazi, une intensification de la
propagande et du culte de la personnalité du Duce. Le comte Galeazzo Ciano,
gendre de Mussolini et ministre des Affaires étrangères, est l’artisan de la «
germanisation » croissante de la politique extérieure, autour de l’« Axe
Rome-Berlin ». L’Italie se joint à l’Allemagne et au Japon, dans le pacte «
anti-Komintern » (6 nov. 1937), quitte la Société des Nations et soutient
militairement les nationalistes de Franco dans la guerre civile espagnole. Après
le répit de la Conférence de Munich (29-30 sept. 1938), la marche à la guerre
reprend, et Rome s’aligne de plus en plus étroitement sur Berlin. À l’automne de
1938 est édictée une législation raciste, et les juifs sont persécutés. Le 22
mai 1939 est signée l’alliance italo-allemande. Après l’occupation de la
Tchécoslovaquie par les nazis, Mussolini s’octroie une compensation en
envahissant l’Albanie, le 7 avril 1939. La crise polonaise déclenche les
hostilités entre l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. L’Italie n’est
pas prête pour la guerre, et elle déclare sa « non-belligérance ». Elle entre en
guerre par la volonté de Mussolini, qui prévaut sur les conseils de prudence des
experts, le 10 juin 1940, lorsque la France est déjà vaincue. Désormais, le sort
du régime fasciste est étroitement lié à celui de l’Allemagne qui a l’initiative
des opérations. Une guerre maritime et aérienne se poursuit, dans des conditions
difficiles, en Méditerranée. L’enjeu en est le ravitaillement des troupes qui,
en Libye, renforcées par l’Afrikakorps allemand, connaissent contre les Anglais
des alternances de succès et de revers. Mussolini attaque la Grèce, mais
l’offensive échoue, avec de lourdes pertes (28 oct. 1940-avr. 1941). Après
l’invasion de la Yougoslavie par les Allemands, l’Italie organise un éphémère
royaume de Croatie, donné au duc de Spolète, qui ne prend pas possession de son
trône. Un corps expéditionnaire est envoyé en Russie, où il subira de dures
épreuves. En Afrique orientale, les Italiens sont chassés de l’Érythrée, de la
Somalie et de l’Éthiopie. Ils perdent la Tripolitaine, au cours de l’automne
1942, et capitulent, le 12 mars 1943. Le 13 juillet 1943, les Alliés débarquent
en Sicile, occupent l’île et progressent vers le Nord. La population de la
péninsule, bombardée par l’aviation, soumise à de pénibles restrictions
alimentaires, manifeste une hostilité croissante au fascisme, qui se traduit,
dans les métropoles du Nord, par les grandes grèves de mars 1943. Un front
clandestin des partis antifascistes s’organise, tandis que des dissensions
apparaissent parmi les dirigeants du fascisme. Le 25 juillet 1943, le Grand
Conseil fasciste vote un ordre du jour désavouant Mussolini. Le roi saisit ce
prétexte pour le destituer, le faire arrêter et le remplacer par le maréchal
Pietro Badoglio qui entame, avec les Alliés, des pourparlers en vue d’un
armistice, signé le 29 septembre. Mais le nouveau gouvernement ne réussit pas à
éviter une prompte réaction des Allemands qui resserrent étroitement leur
occupation et désarment l’armée italienne. Ils libèrent Mussolini, enlevé au
Gran Sasso d’Italia par un détachement aérien, et le chargent de former à Saló,
en haute Italie, un nouveau gouvernement, la République sociale italienne, qui
n’est qu’un jouet dans les mains des nazis. Le cabinet Badoglio et le souverain,
installés dans la partie du pays libérée par les Alliés, déclarent la guerre à
l’Axe le 13 octobre et reçoivent un statut de cobelligérants. L’offensive alliée
progresse très lentement, jalonnée par la prise de la Sardaigne, de la Corse, la
chute de Naples (1er oct. 1943) puis, après la sanglante bataille du mont
Cassin, en juin 1944, la libération de Rome (4 juin). Les opérations s’enlisent
ensuite, pour de longs mois, devant la Ligne gothique, qui n’est enfoncée que
dans la seconde moitié d’avril 1945. La péninsule est coupée en deux. Après le 8
septembre, les six partis antifascistes se groupent dans le Comité de libération
nationale (C.L.N.) qui a deux centres directeurs, à Milan et à Rome. Il organise
l’action de guérilla des partisans, qui reçoivent des parachutages d’armes et
d’équipements, et harcèlent les troupes allemandes. La majorité du C.L.N.,
républicaine, met en accusation la dynastie, pour sa collusion avec le fascisme.
En avril 1944, Victor-Emmanuel III déclare qu’il se retirera, une fois Rome
libérée. Son fils, le prince de Piémont, Humbert, devient lieutenant général du
royaume. Un référendum devra décider, à la fin de la guerre, entre république et
monarchie. Dans l’Italie occupée par les Alliés, Badoglio est remplacé, le 9
juin 1944, par un cabinet de coalition, présidé par Bonomi. Dans la haute
Italie, à partir du 25 avril 1945, une insurrection nationale, mêlant aux
partisans les insurgés des villes, impose aux Allemands une capitulation, signée
à Caserte, le 29. Mussolini, de Milan, après avoir cherché en vain à se livrer
aux Alliés, cherche à gagner la Suisse dans un convoi militaire allemand. Arrêté
par les partisans, à Dongo, sur les bords du lac de Côme, il est exécuté, le 28
avril, avec sa maîtresse, Clara Petacci, et quinze « hiérarques » fascistes. En
juin 1945, Ferruccio Parri succède à Bonomi, puis, en décembre, De Gasperi forme
un gouvernement, avec la mission de préparer les élections à une Assemblée
constituante. Le 9 mai 1946, Victor-Emmanuel III abdique en faveur de son fils,
Humbert II, mais, le 2 juin, le référendum tranche en faveur de la république,
par 12 717 923 voix contre 10 719 284.